Philosophe spécialiste des Lumières et des précurseurs du socialisme, Stéphanie Roza vient de publier « La gauche contre les Lumières ? » (Fayard, 2020) dans lequel elle revient sur l’émergence, au sein de la gauche intellectuelle, d’une critique radicale contre les principes fondateurs des Lumières, au risque de jeter le bébé avec l’eau du bain. À l’heure où le rapport à l’universalisme, à la science ou au progrès sont au cœur du débat public, nous avons souhaité nous entretenir avec elle.
Le Comptoir : Dans votre livre, vous analysez la manière dont s’est développée dans une partie de la gauche, à partir des années 1970, une critique radicale contre l’universalisme, le rationalisme et le progressisme des Lumières. En quoi s’agit-il d’une rupture avec les critiques qui avaient déjà pu être observées depuis le XIXe siècle ?
Stéphanie Roza : Dès le XIXe siècle, il y a déjà des critiques du machinisme mais qui ne sont pas forcément dirigées contre le progrès en tant que tel. En revanche, au début du XXe siècle, des syndicalistes révolutionnaires en rupture de ban par rapport au mouvement socialiste et la Deuxième Internationale, comme Georges Sorel et un certain nombre d’intellectuels regroupés autour de la Revue socialiste, développent une critique très radicale du progrès. Ce dernier est accusé d’être une valeur portée par la République bourgeoise qui compromet le mouvement ouvrier avec la bourgeoisie républicaine.
S’il s’agit d’une critique radicale de l’héritage des Lumières, ce n’est pas une critique du rationalisme. Sorel prend soin de distinguer le rationalisme des Lumières, critiquable car lié au progressisme, du rationalisme de Pascal au XVIIe siècle qui constitue à ses yeux le bon rationalisme.
Cette critique reste toutefois limitée à l’entourage de Sorel et ne débordera pas sur le mouvement ouvrier, la CGT et les socialistes. Une bonne partie de ce très petit groupe partira vers l’extrême droite. Comme l’a montré Zeev Sternhell, les idées soréliennes auront une influence sur Mussolini et constitueront l’une des sources du fascisme italien. Georges Valois fondera même le premier parti fasciste français et Hubert Lagardelle deviendra ministre du travail sous Pétain…
Dans les années 1970, la critique est à la fois plus radicale sur le plan philosophique puisque, chez Michel Foucault et Jacques Derrida, la raison est en soi à rejeter, mais prend également plus de poids au sein de la gauche. Progressivement, l’héritage de Foucault va devenir particulièrement présent dans la gauche intellectuelle. La critique radicale du progrès va également fonder des mouvements décroissants au sein desquels quelqu’un comme Jean-Claude Michéa a un certain écho. Ce sont des critiques beaucoup plus massives au sein de la gauche aujourd’hui.
Quel est votre regard sur le concept d’intersectionnalité et ses usages qui font aujourd’hui débat ?
Je ne suis pas hostile à l’idée que l’on puisse prendre en compte des discriminations qui peuvent s’empiler, d’autant que ce n’est pas une découverte. C’est même une idée assez banale prise en compte depuis longtemps à gauche dans le mouvement ouvrier, féministe ou antiraciste. Les revendications féministes dans le mouvement ouvrier émergent notamment avec l’idée déjà chez Marx que « La femme est le prolétaire de l’homme » et qu’il existe une double oppression. En revanche, le concept d’intersectionnalité dans ses usages actuels provient de militants et d’intellectuels, comme Kimberlé Crenshaw, qui militent ouvertement pour une politique de l’identité. Elle l’écrit très clairement dès son article fondateur : la race et le genre sont plus déterminants que la classe. Crenshaw considère même que la classe est une conséquence de la race et du genre. Ce n’est pas possible de faire plus anti-marxiste et plus éloigné de la manière dont les combats pour l’émancipation ont été menés jusqu’à présent. La mise à l’écart des problématiques socio-économiques est centrale et, en tant que représentante de la vieille tradition socialiste, je ne suis pas du tout d’accord avec cette approche.
Dans le débat public, les questions de race et de genre finissent aujourd’hui par faire écran aux problématiques sociales, comme on l’observe avec cette notion délirante de « privilège blanc ». Des personnalités noires, journalistes, ultra-médiatiques, ayant toutes leurs entrées dans les salons parisiens expliquent qu’il existerait un « privilège blanc », et, par conséquent, que les gens au RSA et les mères célibataires dans le fin fond des Ardennes ou de la Basse-Normandie seraient « privilégiées ». D’un point de vue de gauche, c’est renversant !
L’ouvrage de Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, Races et sciences sociales, qui avait été précédé d’un article dans le Monde Diplomatique et analyse de façon critique l’intersectionnalité, a fait l’objet d’une violente cabale médiatique et sur les réseaux sociaux. Comment expliquer ces réactions ?
Si j’ai également été surprise par la violence des réactions, elle s’explique à mon avis par la publication en 2019 par Gérard Noiriel de son livre Le Venin dans la plume dans lequel il comparait Édouard Drumont et Éric Zemmour en expliquant que la haine du premier pour les juifs était comparable à celle du second pour les musulmans. Cette analogie historique, qui me paraît largement excessive et peu sérieuse venant d’un historien, a pu amener le milieu militant à considérer Noiriel comme étant dans le camp des intersectionnels et des indigénistes. Dès lors, ce nouveau livre peut apparaître comme une volte-face expliquant la violence des attaques.
Il faut également ajouter que l’atmosphère est devenue complètement empoisonnée. Nous sommes quand même en pleine pandémie, dans un contexte où les gens ne vont pas bien, se retrouvent seuls chez eux, derrière leur ordinateur et en arrivent à des niveaux de violence verbale qu’ils n’auraient pas face à quelqu’un dans la vraie vie. Enfin, la logique des anti-universalistes est une logique de surenchère. Ces gens sont dans une fuite en avant vers toujours plus d’agressivité contre ceux qui ne sont pas d’accord avec eux, en particulier vis-à-vis des personnes qui viennent de la gauche. On n’est jamais assez purs pour eux et il s’agit d’excommunier les hérétiques.
Vous soulignez que, contrairement à une idée répandue, la vision attribuée aux Lumières d’une croyance aveugle dans un progrès linéaire, mécanique, irréversible des sciences et des techniques amenées à s’imposer aux peuples est une reconstruction historique. Pouvez-vous expliquer ce malentendu ?
Si l’on a autant de discussions aujourd’hui sur la question des progrès, c’est d’abord parce que l’on se rend bien compte des dégâts du progrès technologique et industriel tel qu’on l’a connu, et il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. On est forcé de s’interroger sur le concept de progrès et j’ai voulu rappeler que depuis le XVIIIe siècle, c’est une notion complexe. Les Lumières, que l’on a tendance à présenter rétrospectivement comme un mouvement univoque, sont traversées par énormément de polémiques et de débats, en particulier sur la question du progrès. La question était de savoir si les progrès des sciences et des arts amenaient mécaniquement ou pas le progrès moral ou des mœurs, comme on disait au XVIIIe siècle. Rousseau, qui est pourtant l’auteur du Contrat social, a un rapport d’autocritique vis-à-vis des Lumières. Dans le Discours sur les sciences et les arts, il dit que le progrès des sciences et des arts nous corrompt moralement et rend les sociétés plus malades qu’elles ne l’étaient. D’autres, comme Montesquieu ou Voltaire estiment que le progrès des arts et des sciences ainsi que le développement du « doux commerce », rapprochent les peuples mais ce n’est pas une opinion partagée par tous. Ceci conduira au débat de savoir s’il faut en finir avec la réglementation du prix du grain par l’État royal, en libéralisant le marché, ou si cela ne risque pas de dérégler l’économie et générer des problèmes d’approvisionnement. Là aussi, il y a débat.
« S’il existe un courant libéral au sein des Lumières et progressiste au sens commun du terme, il existe aussi des courants minoritaires proposant une vision du monde et du progrès plus égalitariste. Les Lumières sont un courant pluriel. »
Quelle a été l’influence des penseurs liés à la révolution conservatrice allemande (Spengler, Heidegger) sur Max Horkheimer et Theodor Adorno dans leur critique du règne de la technique, de la raison ou de la marchandisation de la science ? N’y-a-t-il pas un risque de réduire l’ École de Francfort à ces influences encombrantes ?
Je tiens d’abord à souligner que je n’incrimine pas l’École de Francfort en général ni l’ensemble du travail d’Adorno et Horkeimer mais que mon propos porte sur la Dialectique de la raison — texte sur lequel ils sont d’ailleurs revenus de façon critique. Dans ce texte publié dans les années 1940, ils rejettent la raison dans son fondement même. Raisonner de manière logique, c’est déjà contraindre et hiérarchiser donc dominer. L’ École de Francfort est d’ailleurs d’autant moins à incriminer dans son ensemble qu’Habermas qui est l’un de ses héritiers a lui-même critiqué la Dialectique de la raison au nom du rationalisme.
En revanche, cette critique isolée dans les années 1940 est reprise par Foucault, Derrida et la french theory dans les années 1960-1970. Or, Foucault cite abondamment Nietzsche qui est dans une critique radicale de la raison dès la fin du XIXe siècle et pas du tout d’un point de vue de gauche. Il fait le lien entre le rationalisme, le progressisme, l’universalisme des Lumières et le socialisme contre lequel il est en guerre.
Il y a un grand malentendu sur l’héritage de Nietzsche, notamment en France, où des gens pensent que c’est un auteur subversif et progressiste. Lui-même se prononce ouvertement pour l’esclavage, explique que les nobles se sont avilis quand ils ont abandonné leurs privilèges lors de la nuit du 4 août 1789 et cite les théories racistes de son époque. Il faut vraiment faire une lecture sélective des textes de Nietzsche sans s’intéresser au sens global pour voir en lui un penseur de l’émancipation. Finalement, les « nietzschéens de gauche » comme Foucault s’avèrent être des gens beaucoup plus troubles d’un point de vue politique que ce que l’on a voulu faire croire…
Foucault est d’ailleurs en guerre contre le marxisme et la tradition socialiste…
Oui, s’il apparaît aujourd’hui comme un penseur de gauche, rappelons qu’à l’époque il fait campagne contre le marxisme et l’union de la gauche. Foucault soutient André Glucksmann quand ce dernier sort son pamphlet Les maîtres penseurs (1977), déclare que la tradition socialiste est raciste, entièrement condamnable, et serait proche de ce que l’on a appelé la « deuxième gauche ». La démarche de Foucault est une démarche de substitution par rapport à la tradition socialiste historique.
Vous reprenez le concept d’Anti-lumières à Zeev Sternhell, qui tend à créer une filiation entre des contre-révolutionnaires du XVIIIe siècle, comme Joseph de Maistre ou Edmund Burke, et des penseurs de la révolution conservatrice allemande des années 1920 dont certains se sont directement compromis dans le nazisme.
N’y-a-t-il pas là une focalisation sur les idées qui néglige les facteurs politiques, économique, sociaux ou religieux dans la construction des idéologies ? Une critique que vous adressez par ailleurs à ceux qui font des Lumières la cause principale des totalitarismes et de tous nos maux contemporains.
Zeev Sternhell a été au centre de polémiques très vives entre historiens et ses travaux ne sont pas sans défauts. Il est vrai qu’il s’intéresse principalement à la bataille des idées sans toujours s’interroger sur leur diffusion. Il oublie en particulier que Sorel a occupé une place marginale dans le mouvement socialiste d’ensemble et que le fascisme avait bien d’autres sources politiques, socio-économiques que les seules idées soréliennes. Je partage en partie ces critiques.
Néanmoins, Sternhell a eu, à mes yeux, une intuition extrêmement puissante car il a été le premier à souligner l’existence d’une contre-modernité idéologique qui s’est construite dès le XVIIIe siècle en opposition aux Lumières, à l’héritage de la Révolution française et dont les schèmes de pensée sont restés à peu près les mêmes. Il y a évidemment des évolutions car les Anti-Lumières ont à réagir face à des facteurs nouveaux, comme l’émergence du socialisme international, mais la matrice conceptuelle reste assez stable. Cette intuition profonde et juste rejoint d’ailleurs celle de Georges Lukacs qui avait exhumé dans La destruction de la raison (1954) toute une tradition d’irrationalisme depuis la Révolution française. Le nazisme a bien sûr de multiples causes, comme le traité de Versailles ou la crise de 1929 mais dans le cœur idéologique du fascisme, il y a la haine explicite de 1789 et la volonté d’annuler la Révolution française. Cela n’explique pas tout et mon livre ne prétend pas tout expliquer. Le succès des Anti-lumières de gauche que je dénonce dans le livre s’explique, outre les raisons idéologiques, par des raisons socio-politiques, comme l’effondrement de l’Union soviétique, le fait que la gauche a perdu sa base de classe, les mutations structurelles dans le monde du travail, mais du point de vue de l’histoire intellectuelle, Sternhell a raison.
À l’heure du défi écologique, défendre les Lumières n’implique-t-il pas de reconsidérer une partie de son héritage du XVIIIe siècle ? Dans son livre Les Lumières à l’âge du vivant, la philosophe Corinne Pelluchon plaide pour un renforcement de ses idéaux émancipateurs — autonomie, idée d’une société d’égaux, rationalisme, unité du genre humain — mais de repenser le sens du progrès technologique, la séparation absolue nature/civilisation ou encore la question de l’universalisme.
Tout d’abord, les Lumières ne sont qu’un héritage et ne pouvaient pas prévoir la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui, ni Marx d’ailleurs. Il y a bien sûr un droit d’inventaire à faire mais qui n’est pas spécifique aux Lumières. Ce que je trouve intéressant dans l’héritage des Lumières concernant la question du progrès, c’est le méliorisme, l’idée qu’il est possible d’améliorer notre condition individuelle et collective par des efforts communs qui passent par le politique et la démocratie.
Les progrès techniques doivent être soumis au débat démocratique. On trouve déjà chez Rousseau et un peu chez Condorcet cette idée qu’il faut soumettre tout cela à la discussion publique afin que nous restions maîtres, en tant que collectivité humaine, de nos progrès. Choisir ceux qui nous intéressent, ceux qui ne nous intéressent pas, ou encore ceux sur lesquels on souhaite revenir. Aujourd’hui, nous devrions à mon sens nous interroger beaucoup plus sur ce que les réseaux sociaux et les nouvelles technologies font de nous et nous demander si nous n’avons pas intérêt à abandonner certaines choses.
« Je crois que le déplacement de la vie politique sur les réseaux sociaux détruit complètement le débat démocratique. Je ne suis donc pas une dévote aveugle du progrès technologique. »
En revanche, si je suis d’accord avec la nécessité de décroître dans un certain nombre de domaines, c’est une erreur de croire que l’on pourra dépolluer uniquement en décroissant. Nous sommes allés tellement loin dans la dégradation de notre environnement qu’il va nous falloir de la science et de la technologie pour conjurer le danger écologique majeur qui pèse sur nous. De la même manière que pour faire face à l’épidémie de Covid-19 provoquée par les conséquences de la mondialisation, on a fait confiance à la science pour développer des vaccins. À propos de la séparation nature/civilisation, le livre de Serge Audier, La cité écologique, qui plaide pour une réconciliation entre le républicanisme, la tradition socialiste et l’écologie politique, apporte une contribution intéressante au débat. Ce qui n’est plus possible, c’est d’être progressiste comme dans les années 1920-1930 mais les décroissants qui fustigent la gauche de l’époque devraient se rappeler que les gens mourraient de faim. Quoi qu’on pense rétrospectivement des plans quinquennaux en Union soviétique, ils répondaient à une nécessité urgente de modernisation et d’industrialisation. La Chine s’est développée à toutes vitesses et on l’accuse de polluer mais elle nourrit et vaccine sa population. Il faut donc être nuancé et remettre les choses dans leur contexte. Si l’on doit rétro-pédaler, cela ne pourra se faire efficacement que de façon rationaliste, sans renoncer au progrès scientifique et technique car cela serait se priver d’une de nos meilleures armes.
Concernant l’universalisme, s’il est vrai qu’une partie des Lumières a défendu la colonisation au XVIIIe siècle, d’autres l’ont fortement critiquée, comme Denis Diderot qui appelait les indigènes à se révolter contre le colonisateur les armes à la main. De façon plus générale, s’imaginer que les colonisateurs français ont colonisé parce qu’ils étaient pénétrés par leur mission civilisatrice, c’est quand même avoir un raisonnement anti-matérialiste et croire que les idées mènent le monde. La Grande-Bretagne, l’Italie ou l’Allemagne ont colonisé sans avoir besoin d’invoquer les Lumières. Ce mouvement a davantage à voir avec l’économie européenne et il ne faut pas être dupe des justifications en surestimant le rôle de l’idéologie. Si l’on reste sur les idées, on peut d’ailleurs aussi bien opposer que les Lumières ont justifié la décolonisation. C’est au nom de ces idéaux que des leaders indépendantistes ont justifié leur lutte contre le colonisateur. Finalement, les Lumières représentent un mouvement pluriel qui a permis de mettre en avant l’idée de droits humains, même s’ils ne sont pas partout respectés. En ce sens, la Déclaration des droits de l’Homme est quand même un progrès par rapport à la situation qui prévalait auparavant. De ce point de vue, les Lumières restent quelque chose de positif pour l’histoire de l’Humanité.


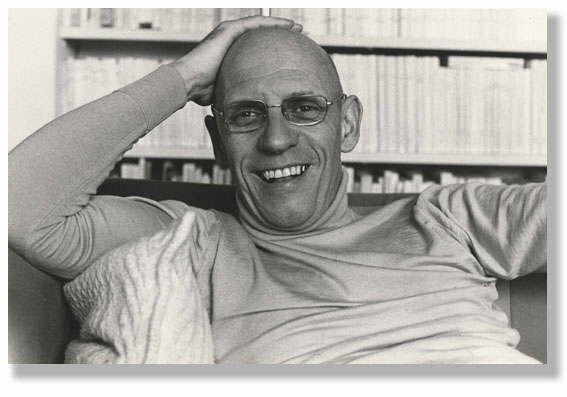
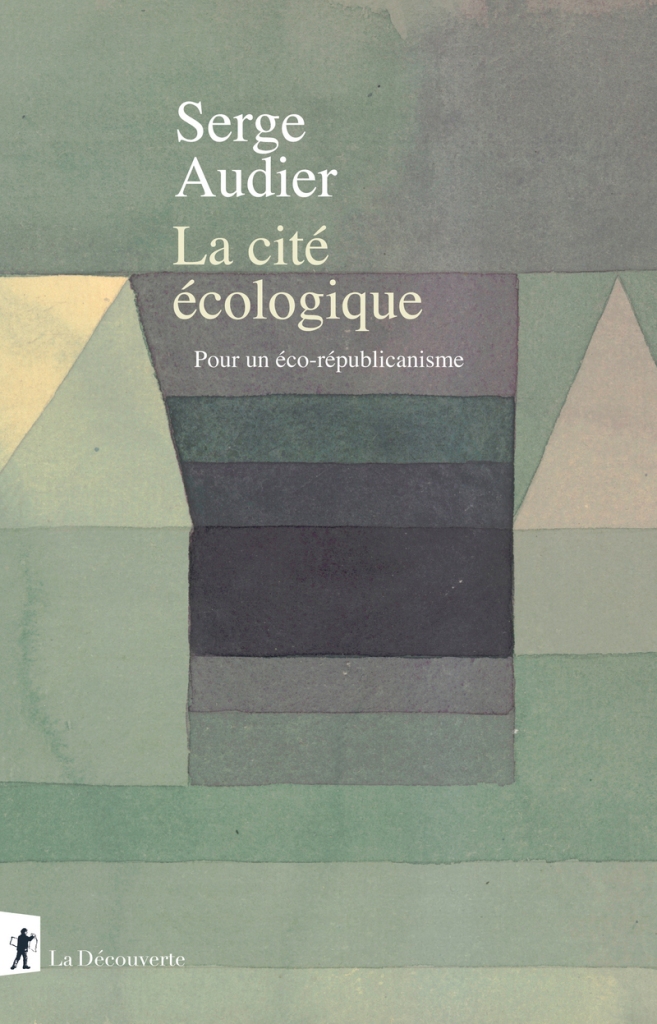
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire