Rechercher dans ce blog
Description
Affichage des articles dont le libellé est Debats. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Debats. Afficher tous les articles
Ce qu’est le macronisme culturel par Olivier Neveux
Professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre à l’Ecole normale supérieure de Lyon, l’hyperactif Olivier Neveux est un esprit vif qui nourrit le débat. Dans son dernier ouvrage, il analyse les rapports entre théâtre et politique. Et entame un tour de France pour rencontrer les professionnels et le grand public.
Qu’est-ce que le « macronisme culturel » ?
C’est peut-être faire trop d’honneur aux fondés de pouvoir actuels du Capital que de les créditer d’une pensée sur l’art et la culture. Le macronisme est banalement néolibéral, c’est-à-dire aimanté par l’intérêt privé (les profits de quelques-uns), dépourvu de toute vision historique, sinon celle d’une agitation toute start-upienne au service du marché. Pour l’art et la culture, les choses fonctionnent comme ailleurs, peut-être de façon plus brouillonne et improvisée : au nom d’arguments comptables et « pragmatiques » (s’adapter au nouveau monde) ou de communication sympathique (la souplesse, la fluidité, la proximité), le macronisme précarise, vassalise, privatise et détruit. Et il rencontre pour cela, parfois, de valeureux agents dans le monde artistique, qui trouvent, eux aussi, qu’il faut « être de son temps ». Car le macronisme culturel est aussi la conséquence d’une victoire idéologique. Il rencontre heureusement quelques résistances (plus ou moins organisées, vives, conséquentes).
La majorité actuelle attaque-t-elle selon vous le modèle culturel français ? Le remet-elle en cause ?
Elle attaque de toutes parts les acquis et les conquêtes sociales, des retraites à la fonction publique, etc. Il n’y a aucune raison qu’elle ne le fasse pas aussi pour les questions culturelles. Une tribune, tardive mais intéressante signée par des organisations syndicales, le disait cet été. Il faut préciser : il ne s’agit pas, pour autant, de valider ce qui existe en l’état. Je soutiens que le service public ne démérite pas de ses missions — en regard de ses moyens, de ses possibilités et de la structuration inégalitaire de notre société. Cela ne signifie pas, loin de là, pour autant qu’il faille se satisfaire de ce qui existe et qu’il n’y a rien à en dire. Mais de la même façon que la SNCF était loin, très loin même, de répondre à ce que doit être un service public de transport, les attaques portées à son encontre ne la rende ni plus juste ni plus égalitaire (ni plus efficace). Il en va de même pour la culture.
Vous parlez de « dépolitique culturelle »...
Oui c’est là un mouvement récurrent. Tout tend à abstraire la politique de ce qui la conditionne : une pensée du conflit, de la délibération contradictoire, l’existence d’alternatives. Chaque chose ne se présente que sous couvert de « pragmatisme » ou de « réalisme ». Le personnel macroniste est pourtant shooté à l’idéologie. Certes il le dénie mais la nécessaire adaptation aux dynamiques du monde (tel qu’il nous emmène droit dans le mur) est une affirmation idéologique. Tout dès lors fonctionne de manière verticale, autoritaire : la façon dont ils ont traité cet été la mise en garde des cinéastes à propos de la nomination de Boutonnat dit le peu de cas qu’ils font de leurs interlocuteurs. Mais ce n’est là que la version policée de ce que les « Gilets jaunes » ont pu vivre, elles et eux, de manière policière et physique. La chose est d’ailleurs largement documentée : démocratie et néolibéralisme entrent inéluctablement en contradiction. Pour l’instant, c’est le néolibéralisme qui gagne.
Les élites délaissent le théâtre et la culture dite de service public ?
Je me fie à ce que dit Olivier Py du festival d’Avignon. Mais cela se vérifie, ailleurs, de façon, il est vrai, empirique. Si par « élite », on entend celles et ceux qui sont en position de pouvoir et de décision : cela fait peu de doute. Cela ne signifie pas, loin de là, que, par un phénomène de vase communicant mécanique, un vaste public populaire s’y soit substitué. Longtemps le théâtre a incarné en quelque sorte « plus » que lui-même. Le pouvoir se sentait requis de s’y intéresser, de s’y montrer aussi. Ce n’est plus le cas, il est symboliquement très dévalué. Il s’agit là d’une dynamique : la transformation sensible de la classe dirigeante et la déconsidération de l’art et des « sciences humaines » qui en est l’une des manifestations. Parfois, l’inculture au plus haut sommet de l’Etat est même valorisée (je me garderai bien, pour autant, d’expliquer la brutalité de leurs politiques par cette grossièreté arrogante : le « raffinement esthétique » n’est pas, à l’inverse, un rempart très consistant face à la barbarie).
Le théâtre est-il de plus en plus politique ?
Je ne sais pas trop ce que cela pourrait signifier. Mais assurément, l’heure est à la multiplication des revendications d’une essence ou d’une politique du théâtre — de la part des tutelles, des critiques et des artistes. Politique, d’une certaine façon, il l’est toujours. Ce qui m’intéresse, toutefois, c’est de travailler sur l’autre façon : celle qui ne considère pas la « politique » comme un donné mais comme une opération.
Vous stigmatisez la mode des spectacles engagés et citoyens. Pourquoi ?
Non, je ne stigmatise rien a fortiori pas le fait que le théâtre se soucie de rencontrer la politique. Je sais combien l’histoire du théâtre, du moins au XXe et XXIe siècles, est tributaire de ce que la politique lui a permis d’inventer. J’interroge plutôt les aventures du « théâtre politique » et, en l’occurrence, du mot « politique » dès lors qu’il est à ce point employé. Que vient-il recouvrir ? Désigner ? Quel type d’orientation ? Que fait-il au théâtre ? Et, à l’inverse : ce que le théâtre produit sur lui.
Comment définiriez-vous la politique théâtrale actuelle de l’Etat ?
A l’image du reste de sa politique. Tout cela est très cohérent.
A LIRE: Contre le théâtre politique, Olivier Neveux, Editions La Fabrique, 320 pages, 14 euros.
PCF: Ne pas se raconter d’histoires
Ne pas se raconter d’histoires : c’est un point de départ quand on est décidé à vraiment changer les choses. Fleurissent pourtant en ce moment méditations privées, conversations entre amis et tribunes de presse autour d’un thème : la nécessité de l’unité de la gauche pour faire face aux périls historiques qui nous guettent l’an prochain. L’air tient souvent de la lamentation : la salvatrice unité de la gauche serait essentiellement entravée par des egos de grenouille (celle de la fable, vous savez) ; crevez-les et pourrait alors s’ouvrir un chemin de victoire. Qu’il y ait des egos et des calculs de mesquine tactique ici ou là, c’est indéniable mais disons-le tout net : on se raconte des histoires en plaçant là les problèmes principaux : ego des uns ; unité des partis politiques de gauche.
Un. « La gauche », il faut s’y faire, c’est toujours des millions de personnes mais ce n’est plus que quelques millions de personnes. Les intentions de vote pour des formations de gauche ? Moins de 30 %, en allant de Arthaud (LO) à Jadot (EELV) – étant entendu que ce dernier se réclame de la gauche un jour sur deux… Combien de bataillons pour le « peuple de gauche » ? Prenez tous les sondages, c’est la bérézina : on navigue entre 13 et 20 % de personnes se déclarant de gauche. Rien d’étonnant quand la gauche déçoit crescendo, de Mitterrand en Jospin et de Jospin en Hollande. Croire que le rassemblement de ces 13-20 % est la clé de tout, c’est nager entre le rêve et la nostalgie.
« Quand la gauche déçoit crescendo, de Mitterrand en Jospin et de Jospin en Hollande, croire que le rassemblement de ces 13-20 % est la clé de tout, c’est nager entre le rêve et la nostalgie. »
Deux. Le problème d’unité n’est pas tant celui de dirigeants qui ne parviendraient pas à se mettre d’accord : c’est dans ce qu’il reste du « peuple de gauche » lui-même que les divisions sont extrêmement profondes. La question n’est pas nouvelle : se pose toujours l’enjeu des reports de voix au second tour face à la droite. Les électeurs socialistes des années 1970 n’aimaient pas toujours les communistes et, dans un second tour opposant un communiste à la droite, des voix pouvaient manquer à l’appel, quelles que soient les consignes de vote officielles. Il pouvait également y avoir de la perte (souvent moindre, il est vrai) dans l’autre sens : certains électeurs communistes n’allant pas voter socialiste au second tour face à la droite. Reste qu’on n’arrive pas à imaginer une déperdition de voix significative si l’adversaire à battre avait été non pas de droite mais d’extrême droite. Face à pareil danger, on voit mal le « peuple de gauche » se refuser à soutenir le candidat de gauche le mieux placé. Bref, division il y a depuis longtemps – et c’est heureux car les projets ne sont pas les mêmes : rêver d’une gauche sans division aucune, c’est signer la mort des familles idéologiques et politiques différentes qui la composent – mais une division qui, pendant plusieurs décennies, ne s’est pas révélée complètement insurmontable. Nous n’en sommes plus là.
On a beaucoup commenté, mi-avril, le fait qu’en cas de second tour d’un candidat de gauche face à Le Pen (hypothèse sans fondement au vu des intentions de vote de premier tour), la victoire du RN était au bout du chemin, Le Pen faisant 60 % face à Mélenchon, 53 % face à Jadot, 50 % face à Hidalgo(1). On en est resté là, et il est vrai que c’était déjà pas mal. Mais si on entre dans les détails, on trouve un paysage qu’il vaut la peine de regarder en face. En cas de deuxième tour Mélenchon-Le Pen, la majorité absolue des électeurs du PS (ici, dans l’hypothèse d’une candidature Hidalgo de premier tour) choisirait l’abstention (54 %) plutôt que le vote FI (42 %) ! La réciproque est un peu moins vraie mais le report d’électeurs FI du premier tour vers Hidalgo au second serait à peine majoritaire (53 %). Comment dire avec plus de netteté la profondeur des divisions, non pas entre ténors égocentriques, mais dans ce « peuple de gauche » lui-même ! On se paie de mots quand on cite paresseusement les enquêtes indiquant que les électeurs de gauche aspirent à un candidat unique. Oui, ils veulent un candidat unique : celui qu’ils portent dans leur cœur, mais surtout pas le voisin ! À aucun prix. Même face à Le Pen !
« Le monde qui nous attend après la pandémie ne sera pas de tout repos et ne laissera guère la place à des demi-mesures et des non-choix.Résumons : le « peuple de gauche » a fondu comme neige au soleil ; ce qu’il en reste est lourdement divisé, indépendamment des consignes des uns et des egos des autres.Trois. S’il faut considérer PCF, FI, EELV, PS, qui peut sincèrement soutenir que ces formations portent un projet commun pour la France, viable et alternatif à ce qui se fait aujourd’hui et ce qui se promet du côté des libéraux et de l’extrême droite ? Prenons les grandes questions économiques, sociales : écoutons les uns et les autres, et mesurons la polyphonie (si on veut habiller de ce nom les contradictions d’une cacophonie politique). Prenons les institutions. Prenons la laïcité. Prenons même, comme y invitait récemment Serge Halimi, les questions internationales. Une chose est de gérer ensemble une commune, un département, une région ; autre chose est de gouverner un pays. Ajoutons car, décidément, il ne faut pas se raconter d’histoires. Déjà quand elles sont dans l’opposition et en campagne, les forces les plus timides de la gauche ne s’engagent pas sur des changements significatifs, alors on n’ose imaginer ce que cela pourrait donner au pouvoir face aux vents violents qui soufflent sur notre monde. Combien de semaines, de jours avant d’annoncer la « pause », avant d’amorcer un virage de rigueur ?
Car c’est bien là le – quatrième – problème, on ne s’en sortira pas avec un accord minimaliste façon plus petit dénominateur commun. Le monde qui nous attend après la pandémie ne sera pas de tout repos et ne laissera guère la place à des demi-mesures et des non choix. Alors qu’une hausse forte du chômage est à redouter, on entend déjà les musiques libérales, venues de Bruxelles, de Bercy ou du siège du MEDEF : il va falloir réformer rudement le pays. Le capital a faim et ne restera pas doux spectateur. Encore n’osé-je ici sortir de la dimension la plus conjoncturelle. Si on doit considérer avec sérieux les défis qui se posent à l’humanité, non dans mille ans mais pour ce siècle même, on ne peut pas penser un instant que trois ou quatre mesurettes feront l’affaire. Non, tout accord minimaliste mènera dans le mur et risque si sûrement d’installer, le coup d’après, Le Pen au pouvoir. Rappelons tout de même que ce n’est pas pure fiction. 1981 : l’extrême droite est microscopique. La gauche déçoit. Voici la percée du FN en 1983-1984 ; en 1988, Le Pen pèse déjà 15%. Quand est-ce que le même Le Pen arrive au second tour ? Juste après l’amère expérience de la gauche plurielle. Quand est-ce que Le Pen revient au second tour et dépasse, pour la première fois, les 7,5 millions de voix et les 20 % ? Au lendemain du désastre Hollande. Un petit accord à gauche sur base étroite et c’est le mur garanti.
« Tout accord minimaliste mènera dans le mur et risque si sûrement d’installer, le coup d’après, Le Pen au pouvoir. »Que conclure après ces lignes aux allures d’apocalypse ? Il ne s’agit pas de pleurer en estimant qu’il n’y a pas d’issue. Il n’y a pas d’issue… dans l’addition des maigres forces en présence. L’issue, nous en connaissons le chemin : il faut se battre comme des chiens pour faire grandir la force et la perspective communistes dans notre pays, dans les combats électoraux et dans tous les autres. Cela ne veut pas dire refuser tout accord à gauche, bien au contraire, mais faire grandir le rapport de forces populaire pour arracher un pacte d’engagements qui soit au niveau des attentes, des besoins et des défis, un accord qui soit appuyé sur des millions de personnes conscientes déterminées à prendre en mains leur destin.
Guillaume Roubaud-Quashie, directeur de Cause commune.
(1). Sondages à prendre avec mille pincettes, dans le cas d’un second tour face à Le Pen car une chose est de dire aujourd’hui, par téléphone, sans conséquences, ce qu’on ferait dans l’hypothèse où… ; une autre est, quinze jours après le premier tour, dans un climat politique tout autre, de faire effectivement tel ou tel choix électoral, avec toutes les conséquences réelles que cela peut impliquer.
Stéphanie Roza : « La focalisation sur la race et le genre fait aujourd’hui écran aux questions sociales »
Philosophe spécialiste des Lumières et des précurseurs du socialisme, Stéphanie Roza vient de publier « La gauche contre les Lumières ? » (Fayard, 2020) dans lequel elle revient sur l’émergence, au sein de la gauche intellectuelle, d’une critique radicale contre les principes fondateurs des Lumières, au risque de jeter le bébé avec l’eau du bain. À l’heure où le rapport à l’universalisme, à la science ou au progrès sont au cœur du débat public, nous avons souhaité nous entretenir avec elle.
Le Comptoir : Dans votre livre, vous analysez la manière dont s’est développée dans une partie de la gauche, à partir des années 1970, une critique radicale contre l’universalisme, le rationalisme et le progressisme des Lumières. En quoi s’agit-il d’une rupture avec les critiques qui avaient déjà pu être observées depuis le XIXe siècle ?
Stéphanie Roza : Dès le XIXe siècle, il y a déjà des critiques du machinisme mais qui ne sont pas forcément dirigées contre le progrès en tant que tel. En revanche, au début du XXe siècle, des syndicalistes révolutionnaires en rupture de ban par rapport au mouvement socialiste et la Deuxième Internationale, comme Georges Sorel et un certain nombre d’intellectuels regroupés autour de la Revue socialiste, développent une critique très radicale du progrès. Ce dernier est accusé d’être une valeur portée par la République bourgeoise qui compromet le mouvement ouvrier avec la bourgeoisie républicaine.
S’il s’agit d’une critique radicale de l’héritage des Lumières, ce n’est pas une critique du rationalisme. Sorel prend soin de distinguer le rationalisme des Lumières, critiquable car lié au progressisme, du rationalisme de Pascal au XVIIe siècle qui constitue à ses yeux le bon rationalisme.
Cette critique reste toutefois limitée à l’entourage de Sorel et ne débordera pas sur le mouvement ouvrier, la CGT et les socialistes. Une bonne partie de ce très petit groupe partira vers l’extrême droite. Comme l’a montré Zeev Sternhell, les idées soréliennes auront une influence sur Mussolini et constitueront l’une des sources du fascisme italien. Georges Valois fondera même le premier parti fasciste français et Hubert Lagardelle deviendra ministre du travail sous Pétain…
Dans les années 1970, la critique est à la fois plus radicale sur le plan philosophique puisque, chez Michel Foucault et Jacques Derrida, la raison est en soi à rejeter, mais prend également plus de poids au sein de la gauche. Progressivement, l’héritage de Foucault va devenir particulièrement présent dans la gauche intellectuelle. La critique radicale du progrès va également fonder des mouvements décroissants au sein desquels quelqu’un comme Jean-Claude Michéa a un certain écho. Ce sont des critiques beaucoup plus massives au sein de la gauche aujourd’hui.
Quel est votre regard sur le concept d’intersectionnalité et ses usages qui font aujourd’hui débat ?
Je ne suis pas hostile à l’idée que l’on puisse prendre en compte des discriminations qui peuvent s’empiler, d’autant que ce n’est pas une découverte. C’est même une idée assez banale prise en compte depuis longtemps à gauche dans le mouvement ouvrier, féministe ou antiraciste. Les revendications féministes dans le mouvement ouvrier émergent notamment avec l’idée déjà chez Marx que « La femme est le prolétaire de l’homme » et qu’il existe une double oppression. En revanche, le concept d’intersectionnalité dans ses usages actuels provient de militants et d’intellectuels, comme Kimberlé Crenshaw, qui militent ouvertement pour une politique de l’identité. Elle l’écrit très clairement dès son article fondateur : la race et le genre sont plus déterminants que la classe. Crenshaw considère même que la classe est une conséquence de la race et du genre. Ce n’est pas possible de faire plus anti-marxiste et plus éloigné de la manière dont les combats pour l’émancipation ont été menés jusqu’à présent. La mise à l’écart des problématiques socio-économiques est centrale et, en tant que représentante de la vieille tradition socialiste, je ne suis pas du tout d’accord avec cette approche.
Dans le débat public, les questions de race et de genre finissent aujourd’hui par faire écran aux problématiques sociales, comme on l’observe avec cette notion délirante de « privilège blanc ». Des personnalités noires, journalistes, ultra-médiatiques, ayant toutes leurs entrées dans les salons parisiens expliquent qu’il existerait un « privilège blanc », et, par conséquent, que les gens au RSA et les mères célibataires dans le fin fond des Ardennes ou de la Basse-Normandie seraient « privilégiées ». D’un point de vue de gauche, c’est renversant !
L’ouvrage de Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, Races et sciences sociales, qui avait été précédé d’un article dans le Monde Diplomatique et analyse de façon critique l’intersectionnalité, a fait l’objet d’une violente cabale médiatique et sur les réseaux sociaux. Comment expliquer ces réactions ?
Si j’ai également été surprise par la violence des réactions, elle s’explique à mon avis par la publication en 2019 par Gérard Noiriel de son livre Le Venin dans la plume dans lequel il comparait Édouard Drumont et Éric Zemmour en expliquant que la haine du premier pour les juifs était comparable à celle du second pour les musulmans. Cette analogie historique, qui me paraît largement excessive et peu sérieuse venant d’un historien, a pu amener le milieu militant à considérer Noiriel comme étant dans le camp des intersectionnels et des indigénistes. Dès lors, ce nouveau livre peut apparaître comme une volte-face expliquant la violence des attaques.
Il faut également ajouter que l’atmosphère est devenue complètement empoisonnée. Nous sommes quand même en pleine pandémie, dans un contexte où les gens ne vont pas bien, se retrouvent seuls chez eux, derrière leur ordinateur et en arrivent à des niveaux de violence verbale qu’ils n’auraient pas face à quelqu’un dans la vraie vie. Enfin, la logique des anti-universalistes est une logique de surenchère. Ces gens sont dans une fuite en avant vers toujours plus d’agressivité contre ceux qui ne sont pas d’accord avec eux, en particulier vis-à-vis des personnes qui viennent de la gauche. On n’est jamais assez purs pour eux et il s’agit d’excommunier les hérétiques.
Vous soulignez que, contrairement à une idée répandue, la vision attribuée aux Lumières d’une croyance aveugle dans un progrès linéaire, mécanique, irréversible des sciences et des techniques amenées à s’imposer aux peuples est une reconstruction historique. Pouvez-vous expliquer ce malentendu ?
Si l’on a autant de discussions aujourd’hui sur la question des progrès, c’est d’abord parce que l’on se rend bien compte des dégâts du progrès technologique et industriel tel qu’on l’a connu, et il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. On est forcé de s’interroger sur le concept de progrès et j’ai voulu rappeler que depuis le XVIIIe siècle, c’est une notion complexe. Les Lumières, que l’on a tendance à présenter rétrospectivement comme un mouvement univoque, sont traversées par énormément de polémiques et de débats, en particulier sur la question du progrès. La question était de savoir si les progrès des sciences et des arts amenaient mécaniquement ou pas le progrès moral ou des mœurs, comme on disait au XVIIIe siècle. Rousseau, qui est pourtant l’auteur du Contrat social, a un rapport d’autocritique vis-à-vis des Lumières. Dans le Discours sur les sciences et les arts, il dit que le progrès des sciences et des arts nous corrompt moralement et rend les sociétés plus malades qu’elles ne l’étaient. D’autres, comme Montesquieu ou Voltaire estiment que le progrès des arts et des sciences ainsi que le développement du « doux commerce », rapprochent les peuples mais ce n’est pas une opinion partagée par tous. Ceci conduira au débat de savoir s’il faut en finir avec la réglementation du prix du grain par l’État royal, en libéralisant le marché, ou si cela ne risque pas de dérégler l’économie et générer des problèmes d’approvisionnement. Là aussi, il y a débat.
« S’il existe un courant libéral au sein des Lumières et progressiste au sens commun du terme, il existe aussi des courants minoritaires proposant une vision du monde et du progrès plus égalitariste. Les Lumières sont un courant pluriel. »
Quelle a été l’influence des penseurs liés à la révolution conservatrice allemande (Spengler, Heidegger) sur Max Horkheimer et Theodor Adorno dans leur critique du règne de la technique, de la raison ou de la marchandisation de la science ? N’y-a-t-il pas un risque de réduire l’ École de Francfort à ces influences encombrantes ?
Je tiens d’abord à souligner que je n’incrimine pas l’École de Francfort en général ni l’ensemble du travail d’Adorno et Horkeimer mais que mon propos porte sur la Dialectique de la raison — texte sur lequel ils sont d’ailleurs revenus de façon critique. Dans ce texte publié dans les années 1940, ils rejettent la raison dans son fondement même. Raisonner de manière logique, c’est déjà contraindre et hiérarchiser donc dominer. L’ École de Francfort est d’ailleurs d’autant moins à incriminer dans son ensemble qu’Habermas qui est l’un de ses héritiers a lui-même critiqué la Dialectique de la raison au nom du rationalisme.
En revanche, cette critique isolée dans les années 1940 est reprise par Foucault, Derrida et la french theory dans les années 1960-1970. Or, Foucault cite abondamment Nietzsche qui est dans une critique radicale de la raison dès la fin du XIXe siècle et pas du tout d’un point de vue de gauche. Il fait le lien entre le rationalisme, le progressisme, l’universalisme des Lumières et le socialisme contre lequel il est en guerre.
Il y a un grand malentendu sur l’héritage de Nietzsche, notamment en France, où des gens pensent que c’est un auteur subversif et progressiste. Lui-même se prononce ouvertement pour l’esclavage, explique que les nobles se sont avilis quand ils ont abandonné leurs privilèges lors de la nuit du 4 août 1789 et cite les théories racistes de son époque. Il faut vraiment faire une lecture sélective des textes de Nietzsche sans s’intéresser au sens global pour voir en lui un penseur de l’émancipation. Finalement, les « nietzschéens de gauche » comme Foucault s’avèrent être des gens beaucoup plus troubles d’un point de vue politique que ce que l’on a voulu faire croire…
Foucault est d’ailleurs en guerre contre le marxisme et la tradition socialiste…
Oui, s’il apparaît aujourd’hui comme un penseur de gauche, rappelons qu’à l’époque il fait campagne contre le marxisme et l’union de la gauche. Foucault soutient André Glucksmann quand ce dernier sort son pamphlet Les maîtres penseurs (1977), déclare que la tradition socialiste est raciste, entièrement condamnable, et serait proche de ce que l’on a appelé la « deuxième gauche ». La démarche de Foucault est une démarche de substitution par rapport à la tradition socialiste historique.
Vous reprenez le concept d’Anti-lumières à Zeev Sternhell, qui tend à créer une filiation entre des contre-révolutionnaires du XVIIIe siècle, comme Joseph de Maistre ou Edmund Burke, et des penseurs de la révolution conservatrice allemande des années 1920 dont certains se sont directement compromis dans le nazisme.
N’y-a-t-il pas là une focalisation sur les idées qui néglige les facteurs politiques, économique, sociaux ou religieux dans la construction des idéologies ? Une critique que vous adressez par ailleurs à ceux qui font des Lumières la cause principale des totalitarismes et de tous nos maux contemporains.
Zeev Sternhell a été au centre de polémiques très vives entre historiens et ses travaux ne sont pas sans défauts. Il est vrai qu’il s’intéresse principalement à la bataille des idées sans toujours s’interroger sur leur diffusion. Il oublie en particulier que Sorel a occupé une place marginale dans le mouvement socialiste d’ensemble et que le fascisme avait bien d’autres sources politiques, socio-économiques que les seules idées soréliennes. Je partage en partie ces critiques.
Néanmoins, Sternhell a eu, à mes yeux, une intuition extrêmement puissante car il a été le premier à souligner l’existence d’une contre-modernité idéologique qui s’est construite dès le XVIIIe siècle en opposition aux Lumières, à l’héritage de la Révolution française et dont les schèmes de pensée sont restés à peu près les mêmes. Il y a évidemment des évolutions car les Anti-Lumières ont à réagir face à des facteurs nouveaux, comme l’émergence du socialisme international, mais la matrice conceptuelle reste assez stable. Cette intuition profonde et juste rejoint d’ailleurs celle de Georges Lukacs qui avait exhumé dans La destruction de la raison (1954) toute une tradition d’irrationalisme depuis la Révolution française. Le nazisme a bien sûr de multiples causes, comme le traité de Versailles ou la crise de 1929 mais dans le cœur idéologique du fascisme, il y a la haine explicite de 1789 et la volonté d’annuler la Révolution française. Cela n’explique pas tout et mon livre ne prétend pas tout expliquer. Le succès des Anti-lumières de gauche que je dénonce dans le livre s’explique, outre les raisons idéologiques, par des raisons socio-politiques, comme l’effondrement de l’Union soviétique, le fait que la gauche a perdu sa base de classe, les mutations structurelles dans le monde du travail, mais du point de vue de l’histoire intellectuelle, Sternhell a raison.
À l’heure du défi écologique, défendre les Lumières n’implique-t-il pas de reconsidérer une partie de son héritage du XVIIIe siècle ? Dans son livre Les Lumières à l’âge du vivant, la philosophe Corinne Pelluchon plaide pour un renforcement de ses idéaux émancipateurs — autonomie, idée d’une société d’égaux, rationalisme, unité du genre humain — mais de repenser le sens du progrès technologique, la séparation absolue nature/civilisation ou encore la question de l’universalisme.
Tout d’abord, les Lumières ne sont qu’un héritage et ne pouvaient pas prévoir la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui, ni Marx d’ailleurs. Il y a bien sûr un droit d’inventaire à faire mais qui n’est pas spécifique aux Lumières. Ce que je trouve intéressant dans l’héritage des Lumières concernant la question du progrès, c’est le méliorisme, l’idée qu’il est possible d’améliorer notre condition individuelle et collective par des efforts communs qui passent par le politique et la démocratie.
Les progrès techniques doivent être soumis au débat démocratique. On trouve déjà chez Rousseau et un peu chez Condorcet cette idée qu’il faut soumettre tout cela à la discussion publique afin que nous restions maîtres, en tant que collectivité humaine, de nos progrès. Choisir ceux qui nous intéressent, ceux qui ne nous intéressent pas, ou encore ceux sur lesquels on souhaite revenir. Aujourd’hui, nous devrions à mon sens nous interroger beaucoup plus sur ce que les réseaux sociaux et les nouvelles technologies font de nous et nous demander si nous n’avons pas intérêt à abandonner certaines choses.
« Je crois que le déplacement de la vie politique sur les réseaux sociaux détruit complètement le débat démocratique. Je ne suis donc pas une dévote aveugle du progrès technologique. »
En revanche, si je suis d’accord avec la nécessité de décroître dans un certain nombre de domaines, c’est une erreur de croire que l’on pourra dépolluer uniquement en décroissant. Nous sommes allés tellement loin dans la dégradation de notre environnement qu’il va nous falloir de la science et de la technologie pour conjurer le danger écologique majeur qui pèse sur nous. De la même manière que pour faire face à l’épidémie de Covid-19 provoquée par les conséquences de la mondialisation, on a fait confiance à la science pour développer des vaccins. À propos de la séparation nature/civilisation, le livre de Serge Audier, La cité écologique, qui plaide pour une réconciliation entre le républicanisme, la tradition socialiste et l’écologie politique, apporte une contribution intéressante au débat. Ce qui n’est plus possible, c’est d’être progressiste comme dans les années 1920-1930 mais les décroissants qui fustigent la gauche de l’époque devraient se rappeler que les gens mourraient de faim. Quoi qu’on pense rétrospectivement des plans quinquennaux en Union soviétique, ils répondaient à une nécessité urgente de modernisation et d’industrialisation. La Chine s’est développée à toutes vitesses et on l’accuse de polluer mais elle nourrit et vaccine sa population. Il faut donc être nuancé et remettre les choses dans leur contexte. Si l’on doit rétro-pédaler, cela ne pourra se faire efficacement que de façon rationaliste, sans renoncer au progrès scientifique et technique car cela serait se priver d’une de nos meilleures armes.
Concernant l’universalisme, s’il est vrai qu’une partie des Lumières a défendu la colonisation au XVIIIe siècle, d’autres l’ont fortement critiquée, comme Denis Diderot qui appelait les indigènes à se révolter contre le colonisateur les armes à la main. De façon plus générale, s’imaginer que les colonisateurs français ont colonisé parce qu’ils étaient pénétrés par leur mission civilisatrice, c’est quand même avoir un raisonnement anti-matérialiste et croire que les idées mènent le monde. La Grande-Bretagne, l’Italie ou l’Allemagne ont colonisé sans avoir besoin d’invoquer les Lumières. Ce mouvement a davantage à voir avec l’économie européenne et il ne faut pas être dupe des justifications en surestimant le rôle de l’idéologie. Si l’on reste sur les idées, on peut d’ailleurs aussi bien opposer que les Lumières ont justifié la décolonisation. C’est au nom de ces idéaux que des leaders indépendantistes ont justifié leur lutte contre le colonisateur. Finalement, les Lumières représentent un mouvement pluriel qui a permis de mettre en avant l’idée de droits humains, même s’ils ne sont pas partout respectés. En ce sens, la Déclaration des droits de l’Homme est quand même un progrès par rapport à la situation qui prévalait auparavant. De ce point de vue, les Lumières restent quelque chose de positif pour l’histoire de l’Humanité.
Débats au sein du PCF sur la stratégie et les alliances, et le commentaire de Jean LEVY

Nous publions ce texte de Gilles Mercier même si nous n’en partageons pas l’approche. Il est normal qu’il y ait débats sur le contenu de la campagne.
Mais d’une part, la campagne de Fabien Roussel ne peut se résumer à quelques phrases. La formule de la gauche à 20% est faite contre la pression médiatique, pour contrer des arguments contre la candidature communiste et pour pouvoir parler de la nouveauté de cette candidature communiste, avec un débat nécessaire, mais qui est d’autant plus efficace qu’il se conduit pour la faire gagner.
D’autre part, le rapport de cette candidature avec la gauche n’est pas dans la continuité avec ce qu’a fait le parti depuis 20 ans... Pour notre part, nous ne voulons reproduire ni 1981, ni 1997, l’union de la gauche version programme commun ou gauche plurielle n’est pas notre horizon ni le PS un partenaire privilégié.
Pour autant, nos adversaires sont à droite et à l’extrême droite et notre combat essentiel contre le capital, pour le socialisme. Bien sûr, il y a de nombreux débats, sur la rupture avec le capitalisme comme sur la "transition" socialiste et la place des entreprises privées... Quand Fabien Roussel pense que les riches peuvent accepter de travailler pour autre chose que le profit, au-delà du trait d’humour, il définit finalement assez clairement ce qu’est le socialisme, une société ou le capitalisme est encore là mais ne dirige plus l’état et doit chercher son profit dans la réponse aux besoins...
Enfin, il nous semble que la gravité de la situation politique et sociale bouscule tous ceux qui espèrent à gauche rejouer les scénarios qui ont échoué. N’insultons pas l’avenir !
Le PCF quelle stratégie ?
Le PCF a décidé de présenter un candidat pour les présidentielles. Cette décision rompt avec la politique d’effacement menée jusqu’ici. Mais cette candidature est porteuse de quelle stratégie ?
Mardi 24 aout Fabien Roussel a explicité lors d’une conférence de presse la conception de sa candidature.
« Le problème d’une gauche à 20% et 5 candidatures, ce sont les 20%, pas les 5 candidature » a-t-il plaidé. « la question est que nous faisons-chacun pour que les 20% passent à 40% » « Toutes les voix que nous aurons s’ajouteront au total de la gauche » « Anne Hidalgo sait très bien qu’on ne touche pas les mêmes électorats, on n’est pas concurrents ». Raison pour laquelle « des discussions ont déjà commencé avec les forces de gauche pour que les législatives qui ne sont pas la présidentielle ».
Ces phrases glanées lors de son intervention éclairent la politique du PCF. Pour le Parti, hors de la stratégie de l’union de la gauche point de salut ! Le PS et consort a leur électorat auquel on ne s’adressera pas. Le PCF n’est pas en concurrence avec les autres partis de gauche (traduire social-démocrates) il est en quelque sorte leur partenaire. Il s’agit de regagner les abstentionnistes et ainsi de devenir incontournable pour essayer de refaire ce qui a tant nuit au PCF, la stratégie de l’alliance au détriment du contenu.
Car ces réunions avec les sociaux démocrates sont des réunions de sommet qui ne sont nullement portées par les luttes.
Or les luttes le PCF en est spectateur, il ne les impulse pas. Comment pourrait il le faire puisqu’il a liquidé ses cellules d’entreprise ? Sans lien avec le salariat, le PCF est dans le vide en recherche permanente d’alliance pour exister.
La stratégie du PCF n’est nullement porteuse d’avenir.
L’intervention de Fabien Roussel sur l’économie pose question. Il veut traquer les exilés fiscaux sans pour autant « chasser les grandes fortunes : ils sont très intelligents, ils ont créé, inventé et ne pourront refuser un pacte pour la jeunesse, de participation à l’amélioration du système éducatif et d’augmentation des salaires ». C’est clair, il ne s’agit pas de s’attaquer au capital, ceci est en cohérence avec le prima de la stratégie d’alliance de sommet avec les gérants loyaux du capitalisme.
Et le point de vue de
Ça n'empêche pas Nicolas
Dans les textes, ici présentés, aucune référence n'est faite au carcan dans lequel la France est enfermée : l'Union européenne. C'est-à-dire la structure mise en place par l'oligarchie financière mondialisée, qui fait de notre continent un espace de libre circulation des hommes, des capitaux et des marchandises.
Toutes les lois décrétées par un pouvoir, qui de Mitterrand à Macron, en passant par Chirac, Jospin, Sarkozy et Hollande, visent à museler notre peuple, le privant du droit de légiférer dans l'intérêt de notre peuple.
Ainsi, il n'y a pas de politique progressiste envisageable dans le cadre européen.
Ou le PCF feint d'ignorer cette vérité, et tous ses engagements sont promesses de gascons, ou Roussel ou pas, il n'a aucune stratégie, seulement le désir par des accords à "gauche", de maintenir quelques élus et un groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale, un des objectifs déclarés au congrès de Martigues, en l'an 2000 àùl'objectif déclaré était de conquérir ds "espaces de pouvoir" (sic) !.
Un parti communiste qui ne fait pas de la reconquête de notre souveraineté politique et économique vis-à-vis de Bruxelles, et diplomatique et militaire en sortant de lOtan, ne peut être un parti de transformation sociale.
Ce sont aux membres du PCF de répondre et de choisir.
JEAN LEVY
Fête de l'Humanité 2021 : le face-à-face Gabriel Attal / Philippe Martinez
Revalorisation des salaires, réforme de l’assurance-chômage, relocalisations.…
Nucléaire et renouvelables, l’Académie des sciences remet les pendules à l’heure

«Les énergies renouvelables intermittentes et variables, comme l’éolien et le solaire photovoltaïque, ne peuvent pas, seules, alimenter un réseau électrique de puissance de façon stable et pilotable si leur caractère aléatoire n’est pas compensé. Il faut pour cela disposer de capacités massives de stockage d’énergie et/ou d’unités de production d’énergie électrique de secours pilotables. Le stockage massif d’énergie, autre que celui déjà réalisé au moyen des centrales hydroélectriques de pompage-turbinage, demanderait des capacités que l’on ne voit pas exister dans les décennies qui viennent. La pilotabilité, en absence de ces dernières, ne peut être assurée que par des centrales nucléaires, si l’on exclut les centrales thermiques utilisant les énergies fossiles.»
Le gouvernement face à ses responsabilités et contradictions
Dans son rapport publié il y a quelques jours et intitulé, L’apport de l’énergie nucléaire dans la transition énergétique, aujourd’hui et demain, l’Académie des sciences met le gouvernement face à ses responsabilités et ses contradictions. Elle renvoie également au rayon des fantasmes, les études plus ou moins sérieuses sur la possibilité de passer dans un avenir relativement proche à une production d’électricité presque totalement renouvelable. Le constat fait par l’Académie des sciences est le suivant.
1) Le diagnostic
La transition énergétique passe obligatoirement par «une augmentation importante de la part de l’électricité dans la production et la consommation énergétique, pour atteindre un niveau de l’ordre de 700 à 900 TWh (terawatts-heure) en 2050, presque le double de notre production électrique actuelle. Cette électricité doit être la plus décarbonée possible. Cette croissance prévisible de la demande en électricité est le plus souvent sous-estimée et minimisée dans les divers scénarios proposés pour la transition énergétique.»
2) Les contraintes
«Cette transformation du système énergétique doit prendre en compte l’absolue nécessité de garantir la sécurité d’approvisionnement électrique du pays ce qui impose de maintenir une capacité de production d’électricité mobilisable afin de répondre aux pics de la demande, d’assurer la stabilité du réseau électrique et de conserver un niveau significatif d’indépendance énergétique...»
«Cette transformation du système énergétique doit prendre en compte l’absolue nécessité de garantir la sécurité d’approvisionnement électrique du pays ce qui impose de maintenir une capacité de production d’électricité mobilisable afin de répondre aux pics de la demande, d’assurer la stabilité du réseau électrique et de conserver un niveau significatif d’indépendance énergétique...»
3) Mettre en place une vraie politique de transition énergétique avec l’électricité nucléaire
«L’électronucléaire offre des avantages considérables…. Un RNT [réacteur nucléaire à neutrons thermiques] injecte massivement, 24 heures sur 24, au moins pendant quelque 300 jours par an, de l’électricité décarbonée dans le réseau. La production électrique nucléaire est, en effet, de toutes les sources d’énergie électrique, la moins émettrice de gaz à effet de serre (environ 6 grammes d’équivalent de CO2 par kWh produit). C’est ce qui explique pourquoi la France, qui s’appuie essentiellement sur les énergies nucléaire et hydraulique, produit une électricité décarbonée à plus de 90%. Un parc électronucléaire de RNT assure donc la continuité de la fourniture d’électricité, à un prix limité, et possède, par ailleurs, la capacité de suivi de charge par des possibilités de baisses et montées profondes pour compenser des variations de consommation ou de production des énergies renouvelables intermittentes. »
Mais l’avenir est loin d’être assuré. Le parc nucléaire français fournit aujourd’hui plus de 70% de la production électrique. Elle est totalement décarbonée, abondante, fiable et bon marché.
Pour combien de temps encore?
Les centrales vieillissent. Ainsi, pas moins de 52 des 56 réacteurs en service après la fermeture de ceux de Fessenheim, ont été construits dans les années 1970-1980. Seuls les quatre réacteurs de Chooz et de Civeaux sont plus récents. Tous arriveront en fin de vie d’ici 2040. Même dans l’hypothèse où la loi de transition énergétique serait appliquée, qui prévoit la réduction de la part du nucléaire dans la production électrique à 50%, il faudra donc construire de nouvelles centrales nucléaires pour remplacer une partie du parc existant. Il faudra avoir le courage politique de le reconnaître.
Le gouvernement refuse même que le sujet soit abordé. Cela aura des conséquences importantes sur la stabilité de l’accès à l’électricité. En clair, le risque de pénurie et de black out va augmenter. Pour maintenir en 2035 la production électrique de la France à son niveau et à son coût actuels, EDF table, a minima, sur la construction rapide de trois paires de deux réacteurs de type EPR.
Le gouvernement refuse même que le sujet soit abordé. Cela aura des conséquences importantes sur la stabilité de l’accès à l’électricité. En clair, le risque de pénurie et de black out va augmenter. Pour maintenir en 2035 la production électrique de la France à son niveau et à son coût actuels, EDF table, a minima, sur la construction rapide de trois paires de deux réacteurs de type EPR.
Cela prendra bien plus de 15 ans… Et d’ici 2035, la demande d’électricité augmentera.
4) Les préconisations
-«Conserver la capacité électronucléaire du bouquet énergétique de la France par la prolongation des réacteurs en activité, quand leur fonctionnement est assuré dans des conditions de sûreté optimale, et par la construction de réacteurs de troisième génération, les EPR, dans l’immédiat. Ces derniers reposent sur la meilleure technologie disponible actuellement et offrent les meilleures garanties de sûreté…».
-«Initier et soutenir un ambitieux programme de R&D sur le nucléaire du futur afin de préparer l’émergence en France des réacteurs à neutrons rapides (RNR) innovants de quatrième génération (GenIV), qui constituent une solution d’avenir et dont l’étude se poursuit activement à l’étranger…».
– «Maintenir des filières de formation permettant d’attirer les meilleurs jeunes talents dans tous les domaines de la physique, la chimie, l’ingénierie et les technologies nucléaires pour développer les compétences nationales au meilleur niveau…»
-«Informer le public en toute transparence sur les contraintes des diverses sources d’énergie, l’analyse complète de leur cycle de vie et l’apport de l’électronucléaire dans la transition énergétique en cours.»
On peut ajouter qu’il ne faudrait pas seulement informer le grand public mais aussi bon nombre d’organismes publics qui confondent militantisme et intérêt général.
Car la stratégie de transition énergétique en France est affectée d’une forme de pensée magique. Face à une impasse technique, le gouvernement et nombre d’organismes n’opposent pour l’instant que des scénarios improbables. Ils parient sur l’installation de milliers d’éoliennes, intermittentes, et sur l’hypothèse d’une consommation stable voire en baisse d’électricité.
Une prévision incohérente avec le scénario même de la transition qui nécessite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre l’électrification de nombreux usages dont les transports, le chauffage, l’industrie… C’est exactement ce que dénonce avec force l’Académie des sciences.
(PCF), Rentrée scolaire : un mauvais remake d'Un jour sans fin
Après deux années scolaires marquées par le COVID, l’enjeu de cette rentrée est de taille. Il s’agit, malgré la situation sanitaire qui reste tendue, de permettre à chaque jeune de renouer avec une scolarité à 100% en présentiel. Il s’agit de permettre à chaque élève de rattraper le « temps perdu » depuis 18 mois. Il s’agit de considérer l’école, au même titre que la santé, comme un enjeu de société de premier ordre.

La responsabilité du ministère est de donner aux écoles, aux enseignant-e-s et aux personnels d'éducation les moyens de raccrocher les élèves dont les difficultés se sont aggravées, celles et ceux qui n’ont que l’école pour réussir.
Il y a besoin de garantir la sécurité sanitaire des élèves, des personnels et de leurs familles.
Tout doit être fait pour permettre la vaccination des personnels et des élèves et pour cela entre autre reconstruire une médecine scolaire de qualité en capacité d’intervenir dans tous les établissements et auprès de chaque élève.
Depuis plus d'un an, le PCF propose également de réduire les effectifs par classe, de les dédoubler quand cela est possible et pour cela de recruter 90 000 enseignants en puisant chez les admissibles aux concours de l’enseignement, en recrutant les listes complémentaires, en titularisant des contractuels donnant satisfaction et en poste depuis plus de 3 ans.
Nous proposons en lien avec les communes, les départements un grand plan d’équipement des locaux scolaires en aérateurs, de permettre la création de classes avec des locaux supplémentaires, d’aménager les préaux et les cours de récréation, les salles dédiées à l’EPS, à l’éducation musicale notamment de manière à permettre de revenir à la normalisation des enseignements.
Les élèves après des mois de confinement ont perdu du temps de classe. Or, pour apprendre, il faut être en classe, il faut donc donner aux élèves, aux enseignants du temps pour apprendre.
Il y a besoin d’aménager les programmes scolaires, de regagner 27 heures hebdomadaires en maternelle et primaire, et d’aller ensuite vers les 32 heures de la maternelle au lycée.
Le PCF propose des mesures d’urgence pour répondre aux besoins que fait surgir la crise sanitaire, et au-delà il propose d’engager un véritable débat sur les nécessaires transformations de l’école pour garantir à chacune et chacun les moyens de réussir.
Pour cela il faut du temps pour apprendre, il faut plus de temps de classe, plus d’enseignants et mieux formés, il faut plus de temps pour d’autres pratiques, rééquilibrer les apprentissages, et garantir à chaque élève d’avoir du temps pour réussir sa scolarité.
Le PCF propose :
- vaccination de l’ensemble des personnels et des élèves de collège et lycée
- reconstruction d’une véritable médecine scolaire
- dédoublements des classes
- mise à disposition de locaux et équipement en aérateurs
Sur le plan des apprentissages, nous proposons de redonner du temps pour apprendre :
- 26h dans le premier degré et 32h dans le second
- plus de maîtres que de classes
- remplacement en nombre suffisant pour garantir la continuité des enseignements
- refonte des programmes, programme ambitieux mais réaliste, qui problématise les choses plutôt que d'être un catalogue interminable de notions techniques
- pas d'évaluations nationales qui obligent à faire la course au programme

La responsabilité du ministère est de donner aux écoles, aux enseignant-e-s et aux personnels d'éducation les moyens de raccrocher les élèves dont les difficultés se sont aggravées, celles et ceux qui n’ont que l’école pour réussir.
Il y a besoin de garantir la sécurité sanitaire des élèves, des personnels et de leurs familles.
Tout doit être fait pour permettre la vaccination des personnels et des élèves et pour cela entre autre reconstruire une médecine scolaire de qualité en capacité d’intervenir dans tous les établissements et auprès de chaque élève.
Depuis plus d'un an, le PCF propose également de réduire les effectifs par classe, de les dédoubler quand cela est possible et pour cela de recruter 90 000 enseignants en puisant chez les admissibles aux concours de l’enseignement, en recrutant les listes complémentaires, en titularisant des contractuels donnant satisfaction et en poste depuis plus de 3 ans.
Nous proposons en lien avec les communes, les départements un grand plan d’équipement des locaux scolaires en aérateurs, de permettre la création de classes avec des locaux supplémentaires, d’aménager les préaux et les cours de récréation, les salles dédiées à l’EPS, à l’éducation musicale notamment de manière à permettre de revenir à la normalisation des enseignements.
Les élèves après des mois de confinement ont perdu du temps de classe. Or, pour apprendre, il faut être en classe, il faut donc donner aux élèves, aux enseignants du temps pour apprendre.
Il y a besoin d’aménager les programmes scolaires, de regagner 27 heures hebdomadaires en maternelle et primaire, et d’aller ensuite vers les 32 heures de la maternelle au lycée.
Le PCF propose des mesures d’urgence pour répondre aux besoins que fait surgir la crise sanitaire, et au-delà il propose d’engager un véritable débat sur les nécessaires transformations de l’école pour garantir à chacune et chacun les moyens de réussir.
Pour cela il faut du temps pour apprendre, il faut plus de temps de classe, plus d’enseignants et mieux formés, il faut plus de temps pour d’autres pratiques, rééquilibrer les apprentissages, et garantir à chaque élève d’avoir du temps pour réussir sa scolarité.
Le PCF propose :
- vaccination de l’ensemble des personnels et des élèves de collège et lycée
- reconstruction d’une véritable médecine scolaire
- dédoublements des classes
- mise à disposition de locaux et équipement en aérateurs
Sur le plan des apprentissages, nous proposons de redonner du temps pour apprendre :
- 26h dans le premier degré et 32h dans le second
- plus de maîtres que de classes
- remplacement en nombre suffisant pour garantir la continuité des enseignements
- refonte des programmes, programme ambitieux mais réaliste, qui problématise les choses plutôt que d'être un catalogue interminable de notions techniques
- pas d'évaluations nationales qui obligent à faire la course au programme
« ENSEIGNER LA RÉVOLUTION FRANÇAISE AUJOURD’HUI ».
LES SAMEDI ET DIMANCHE 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021 à partir de 9 heures 30.
AU LYCÉE ROBESPIERRE ARRAS.
AU PROGRAMME DU SECOND CONGRÈS DES ASSOCIATIONS AMIES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Au cœur des débats : « Enseigner la Révolution Française aujourd’hui ».
Trente ans après la célébration du bicentenaire, des progrès de l’historiographie, et de l’évolution des programmes scolaires, quelle révolution est-elle enseignée aux générations d’aujourd’hui ?
Universitaires, professeurs, membres des associations, témoigneront et débattront avec le public selon le programme suivant :
DÉTAIL DE LA JOURNÉE DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Introduction : Paroles de révolutionnaires :
Élèves du Lycée Robespierre sous la conduite artistique de la Compagnie « Avec vue sur la Mer »
Vernissage de l’exposition : Les députés conventionnels du Pas-de-Calais
Table ronde 1 – 11 h – 12 h suivie d’un échange avec la salle
Enseigner la Révolution française aujourd’hui. Témoignages et retours d’expériences
Animation : Samuel Guicheteau formateur en histoire à l’INSPE de Nantes
Participants :
Fabrice Carton directeur d’école rurale Athies ;
Sabine Dumont professeure en Lycée Professionnel - APHG NpdC
Carine Lecointre professeure de Collège - APHG NpdC
Ludovic Vandooleaghe professeur d’histoire géographie au lycée Robespierre ;
Table ronde 2 – 13 h 30 – 14 h 15 suivie d’un échange bref avec la salle
La Révolution française dans les programmes. Perspective historique.
Animation : François Da Rocha Carneiro, Docteur en Histoire contemporaine, université d’Artois - APHG NpdC
Participants :
Dominique Desvignes - ARBR - professeur agrégé honoraire ESPE
Fadi Kassem - ARBR - professeur agrégé d’histoire
Ateliers – 14 h 30 – 15 h 45
* Atelier 1 – Enseigner la république
Animation : Maxime Kaci Maître de Conférences Université de Franche-Comté - SER
Participants :
Bernard Vandeplas, - ARBR - docteur en histoire contemporaine
Gilda Guibert-Landini - ARBR - professeur agrégé d’histoire
Rémi Vernière- ARBR - proviseur de lycée professionnel
* Atelier 2 – La question coloniale en révolution
Animation : Yveline Prouvost membre du bureau de l’APHG NpdC
Participants :
Sihem Bella doctorante et professeure en lycée - APHG NpdC
Bruno Decriem, - ARBR - professeur d’histoire-géographie en Lycée professionnel
Jean-René Genty IGAEN-honoraire, historien - ARBR -
* Atelier 3 – La citoyenneté. Enjeux historiques et civiques
Animation : Annie Duprat : Professeure des universités - SER
Participants :
Gaïd Andro Maître de Conférences Université de Nantes - SER
Suzanne Levin maître de conférences Nanterre - ARBR -
Ann-Laure Liéval - APHG NpdC - professeure en lycée
Table ronde 3 – 16 – 17 h. suivie d’un échange avec la salle
Figures révolutionnaires dans l’espace public et la mémoire collective : mémoire et amnésie.
Animation : Hervé Leuwers : Professeur des Universités, Président de la Société des Études Robespierristes
Participants :
Michel Aurigny (Amis de Babeuf),
Alcide Carton (Amis de Robespierre),
Philippe Gallet (Amis de Camille Desmoulins),
Florent Héricher ( Amis de Philippe Le Bas et de la Famille Duplay)
Daniel Jouteux, Société des Amis de la Révolution Française Club René Levasseur de la Sarthe
Anne Quennedey professeure agrégée docteure en littérature (Amis de Saint-Just).
Conclusions et remerciements : 17 h 17h 30
Hervé Leuwers président de la SER - Alcide Carton président de l’ARBR
Tout au long de la journée : stands des associations, libraires et partenaires.
L’ARBR permet à celles et ceux qui le souhaitent de prolonger leur week-end à Arras
SOIRÉE DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Projection publique du film « Sur les pas de Robespierre » 20 heures
Le film, réalisé en 2016 par des lycéens et des étudiants en cinéma d’Arras, raconte l’histoire d’une classe partant à la découverte du personnage de Robespierre, avocat, à travers la ville d’ARRAS et de son patrimoine historique.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
10 h -13 h : visite touristique robespierriste dans Arras, la cité de Robespierre.
Une visite commentée de la Maison de Robespierre clôturera la visite. Elle sera pilotée par Bernard Sénéca membre de l’ARBR, de l’ASSEMCA et de l’Académie d’Arras. Le projet d’espace muséographique à la Maison de Robespierre sera commenté.
13 h 30 15 h 30 : Banquet républicain
Sur inscription préalable auprès de l’ARBR.
POUR PARTICIPER AU CONGRÈS, EST RECOMMANDÉ DE
s’inscrire vite (nombre de repas limités) sur notre site
ou par mail à l’adresse suivante : association.arbr@amis-robespierre.org. après avoir rempli le formulaire joint ci-dessous.
ou l’avoir renvoyé complété à ARBR, 2. rue de la douizième 62000 ARRAS.
Liste des associations concernées :
SER Société des Etudes Robespierristes
ARBR Amis de Robepsierre
Association Camille Desmoulins
Association Condorcet (Ribemont)
AMRID Assoc. Maximilien Robespierre pour l’idéal démocratique
Association pour la sauvegarde de la maison de Saint-Just
L’improbable (Lyon)
Les amis de Gracchus Babeuf
Société des amis de la Révolution française de la Sarthe (SARF)
Carmagnole LIBERTÉ
Assoc. Des Amis de Philippe Lebas
Le peuple souverain s’avance
Comité républicain de La Roche-de-Mûrs
Les joyeux Jacobins
Le droit de licencier un salarié s’il refuse de se faire vacciner
Le pass sanitaire est obligatoire pour certains salariés à partir du 30 août 2021.
Si le salarié refuse de se faire vacciner l’employeur aura donc le droit de le licencier.
Dans son avant-projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire, le gouvernement liste les professions qui seront concernées par la vaccination ou le pass sanitaire obligatoire.
L'avant-projet de loi sanitaire du gouvernement, consécutif aux annonces du président Emmanuel Macron, concerne :
tous les salariés des activités de loisirs, de restauration ou de débit de boisson, les foires ou salons professionnels, les services et établissements accueillant des personnes vulnérables, les grands établissements et les centres commerciaux ;
tous les personnels soignants et non soignants (personnels administratifs, infirmiers, aides-soignants, médecins, bénévoles…) exerçant leur activité dans :
les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés (hôpitaux, cliniques…) ;
les centres de santé ;
les maisons de santé ;
les centres et les équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion gérés par des organismes à but non lucratif ;
les centres médicaux et les équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
les services de santé scolaire ;
les services de santé au travail ;
certains établissements et services médico-sociaux (établissements ou services d’enseignement dédiés aux mineurs ou jeunes adultes handicapés, établissements ou services d’aide par le travail, établissements ou services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent une assistance à domicile, établissements et services qui accueillent des personnes handicapées…) ;
les logements foyers qui accueillent des personnes âgées ou handicapées.
Le texte prévoit qu'à défaut de présenter à leur employeur un examen de dépistage négatif du Covid-19, une preuve de vaccination ou un certificat de rétablissement, contenus dans le "pass sanitaire", les employés ne pourront plus exercer leur activité.
Concrètement, l’employeur devra respecter une période de mise à pied de deux mois puis procéder au licenciement du salarié qui refuse de respecter ces mesures et de se faire vacciner.
Le défaut de pass sanitaire peut donc justifier un nouveau motif de licenciement.
A ce titre, il convient de rappeler que la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de confirmer le licenciement d'un salarié qui avait refusé de se faire vacciner contre l'hépatite B, alors que les fonctions qu'il assurait l'exposaient au risque de contracter cette maladie.
Dans cet arrêt, la Cour a considéré que lorsque la règlementation applicable à l'entreprise imposait cette vaccination et lorsque celle-ci avait été en outre prescrite par la médecine du travail, le salarié n'était pas fondé à s'opposer à son licenciement en l'absence de toute contre-indication médicale à la vaccination. (Cass. soc., 11 juillet 2012, n°10-27.888)
Le projet de loi prévoit aussi une "procédure incitative plus souple" donnant lieu à "un entretien préalable entre le salarié et l'employeur dans le but d'échanger sur les moyens de régulariser la situation mais aussi de privilégier la pédagogie avant d'arriver à la suspension du contrat".
Cependant, en pratique, le pass sanitaire est compliqué à mettre en oeuvre pour les salariés car le secret médical interdit à l'employeur de vérifier de lui-même l'état de santé de son employé.
En effet, l’employeur ne peut pas vérifier de lui même si son salarié est vacciné ou non, négatif ou positif au Covid.
En principe, seul le médecin du travail peut décréter l’aptitude ou l’inaptitude d’un employé.
Néanmoins, si le Conseil d'État estime que le pass sanitaire puisse constituer une condition indispensable pour pouvoir exercer une activité de travail proportionnée par rapport au risque de contamination et qu’à défaut le salarié puisse faire l’objet d’un licenciement.
Plusieurs vaccins comme ceux contre le tétanos ou l’hépatite B par exemple sont déjà obligatoires pour certains professionnels de santé.
Le cas échéant, l’obligation de vaccination contre le Covid-19 constituerait une exception à la règle posée par l'article L1121-1 du code de santé publique selon lequel aucune substance en phase de recherche ne peut être imposée à une personne sans son consentement libre et éclairé.
Il convient donc de suivre les débats en cours sur la validation de ce projet de texte par le conseil d’état et le conseil constitutionnel pour connaître les conditions dans lesquelles les employeurs pourront se séparer de leurs salariés s’il refusent de se faire vacciner.
À propos du « bloc bourgeois »
La métaphore du « bloc » est employée sous la Troisième République, pour désigner de vastes regroupements visant à la majorité politique : Bloc républicain, Bloc national, Bloc des gauches… Après 1918, elle est peu à peu concurrencée par la thématique plus guerrière du « front », que préfèrent les communistes.
Mais elle se maintient, en se déplaçant vers l’analyse sociale. En 1924, au nom de l’Internationale communiste, Léon Trotsky fustige le « bloc bourgeois », que constitue pour lui le Cartel des gauches (alliance des radicaux et des socialistes), et lui oppose le « bloc ouvrier et paysan » que porte le PCF. La ligne esquissée en 1924 se durcit trois ans plus tard, quand émerge la stratégie internationale dite de « classe contre classe ». Aux tenants de la bourgeoisie en décomposition, s’oppose le bloc prolétarien de rupture anticapitaliste proposé par les seuls communistes. La notion de « fascisation » devient la référence ordonnant l’ensemble de la société (la démocratie se fascise, dit-on volontiers du côté communiste) et permet d’amalgamer, dans la même détestation, l’ensemble des forces politiques en dehors du PC. Une mention spéciale est même destinée aux frères ennemis, les socialistes, désormais qualifiés de « social-fascistes ». La ligne « classe contre classe » et ses conséquences sont abandonnées entre 1934 et 1935, pour laisser la place à l’orientation de front populaire. Si la critique du capitalisme reste en arrière-plan, l’ennemi principal est désormais le fascisme.
La logique binaire revient en force pendant la guerre froide : pour les communistes, tous les partis autres que le leur sont englobés dans le « parti américain » (« Il n’y a plus gauche et droite », écrit à l’automne de 1947 le dirigeant communiste Marcel Cachin dans ses carnets personnels), tandis que, pour les socialistes, « le PCF n’est plus à gauche mais à l’Est ». La ligne de démarcation existe toujours entre deux blocs (« occidental » et « oriental ») entre lesquels il faut nécessairement choisir, mais qui ne se définissent plus comme des blocs de classe.
Le terme de « bloc bourgeois » est revenu après 2017, pour caractériser le phénomène nouveau du macronisme, qui se veut en dehors du conflit de la droite et de la gauche. En 2018, les économistes Bruno Amable et Stefano Palombarini écrivent un stimulant essai, L’illusion du bloc bourgeois (Raisons d’agir), qu’ils sous-titrent Alliances sociales et avenir du modèle français. Ils voient, dans le « bloc bourgeois », le socle du nouveau pouvoir, sans cacher pour autant la complexité voire la fragilité de ce bloc.
En février 2019, en plein mouvement des Gilets jaunes, Le Monde diplomatique, sous la plume de Serge Halimi et Pierre Rimbert (« Lutte de classes en France »), oppose le « bloc populaire » en constitution à un « bloc bourgeois » dominé par la peur de la nouvelle lutte des classes. En décembre 2019, le penseur d’extrême droite, Alain de Benoist, reprend à son tour la thématique du face-à-face dans la revue Éléments. Il y dénonce un « bloc bourgeois » rassemblant « les très riches du CAC 40, les bobos, le personnel des grands médias et les cadres supérieurs enthousiastes de la mondialisation pour qui tout ce qui est "national" est dépassé ».
De Benoist raccorde le binôme à une conception plus globale, qu’il défend depuis longtemps : l’horizontalité de la lutte des classes d’hier (structurée autour de l’égalité) laisse la place à la verticalité du conflit entre « bas » et « haut » (structuré autour de l’identité). Le bloc populaire s’enracine dans les valeurs de la nation, ce qui l’oppose radicalement au cosmopolitisme du bloc bourgeois.
Le 21 mai 2021, le site Le Média, proche de Jean-Luc Mlénchon, publie une contribution du « Stagirite » intitulée « 2022 : le bloc bourgeois s’organise, le bloc de gauche se construit ». Enfin, le 6 juin 2021, le blog de Mélenchon convoque lui aussi la notion de « bloc bourgeois » pour valoriser ce qu’il appelle la « stratégie globale » de « l’union populaire ».
Il en est du bloc bourgeois comme de la caste ou de l’élite : suffisamment flou pour que l’on y englobe tout adversaire potentiel… quand bien même il serait le plus proche de soi.
Les risques d’un concept flou
Comme d’ordinaire, la démonstration se veut rigoureusement sociale : Macron, le « Président des riches » n’est que le point de ralliement d’un bloc social « bourgeois » ; face à lui, il convient donc de constituer un « bloc populaire », capable de parvenir à la majorité dès 2022. Or cette constitution ne peut se faire que sur la base d’une « rupture » permettant d’aller vers « une nouvelle société dont les normes et les valeurs ne seraient plus celles de l’ordre établi ». L’union de la gauche ne rend pas possible une telle rupture (le PS et EELV n’en veulent pas dans les faits) et le PC a décidé de présenter son candidat à la présidentielle.
La solution consiste donc à porter devant les catégories populaires le seul programme existant de rupture : « L’Avenir en commun ». L’objectif stratégique est dès lors de montrer que ce programme est crédible, que le candidat Mélenchon le mettra sincèrement en œuvre et qu’il en a personnellement la capacité. Sur cette triple base, le candidat franchira l’obstacle du premier tour ; au second, enfin, l’union se réalisera, non pas « l’union de la gauche », mais « l’union populaire », c’est-à-dire le moment « où le peuple lui-même s’unit par un vote en commun ».
Un lien logique relie ainsi la référence au « bloc » et la formule stratégique d’une « union populaire » distincte de l’union de la gauche. Or cette référence est lourde d’ambiguïté. Le bloc, tout d’abord, est en général si vague qu’il est extensible à l’infini. Où se situe la limite du « bourgeois » ?
Faut-il y voir le « 1% » opposé aux « 99% » ?
La petite tribu des milliardaires ?
La masse des actionnaires ?
Les décideurs politiques ?
Toutes les couches sociales qui, d’une façon ou d’une autre, bénéficient des retombées du « système » ? Comptera-t-on dans ce bloc l’essentiel des forces politiques, y compris les forces de gauche qui ne seraient pas du côté de la rupture ?
Et si « bourgeois » se confond avec « privilégié », jusqu’où va le champ du privilège ?
Il en est du bloc bourgeois comme de la caste ou de l’élite : suffisamment flou pour que l’on y englobe tout adversaire potentiel… quand bien même il serait le plus proche de soi.
Il ne s’agit bien sûr pas d’ignorer ici le poids de la position sociale dans la distribution des votes. Quand elles font leur choix, les catégories sociales supérieures (les « CSP+ » des sondages) ont une propension massive à se tourner vers la mouvance macronienne et la droite classique. En revanche, les catégories populaires s’abstiennent ou se portent vers l’extrême droite (à la présidentielle) ou vers la droite (aux législatives). Ce qui est avéré est que les catégories les plus modestes ne se tournent plus guère vers la gauche, même si elles l’ont fait un peu plus pour Mélenchon à la présidentielle de 2017.
Mais si la propension des groupes sociaux à voter est politiquement orientée, la structure des électorats est plus complexe. Tout bien considéré (voir encadré), la part des actifs appartenant aux couches supérieures ou aux couches populaires n’est pas si discriminante entre les électorats. À la limite, les plus opposés socialement semblent être celui de Fillon et celui de Le Pen ; et encore faut-il tenir compte du facteur générationnel (l’électorat Fillon est celui qui compte le plus d’inactifs qui ne sont pas majoritairement issus des milieux les plus favorisés). Macron attire avant tout les couches supérieures, mais n’est pas si surclassé qu’on le pense du côté des catégories populaires. Si l’on en croit les sondages, il pourrait même obtenir à lui seul un pourcentage des ouvriers qui votent supérieur à celui de la gauche présidentielle.
Le plus important n’est pas là. Il est dans le constat que la distribution sociale des électeurs ne se déduit pas d’une simple corrélation entre groupes sociaux et vote. Il fut un temps, pas si lointain mais désormais forclos, où les catégories populaires avaient un groupe central (le monde ouvrier) et où ce groupe s’était peu à peu constitué en mouvement (le mouvement ouvrier) agissant à la fois sur la scène sociale et dans le champ politique. Sur cette base s’étaient nouées des relations, toujours complexes mais reproductibles, entre la gauche et le mouvement ouvrier. Dans les phases de plus grande expansion (la Libération, les années 1970), cette conjonction a nourri la concentration majoritaire des votes populaires sur la gauche. Ce n’est pas une corrélation sociale mécanique qui raccorde « classe » et « gauche », mais une construction complexe où s’entremêle de l’objectif et du subjectif, du conscient et de l’inconscient, de la pratique et du symbolique.
La conjonction s’est défaite : le monde ouvrier n’a pas disparu, mais il s’est disloqué. L’unification relative des classes populaires a laissé la place à une dispersion qui brouille les repères traditionnels de la classe et la gauche est entrée en crise. Dès lors, le champ politique fonctionne de moins en moins en forme de blocs. Les groupes sociaux se portent certes plus ou moins vers tel ou tel groupement politique. Mais ce qui domine est le « plus ou moins » : la réalité du champ politique est celle de sa parcellisation, qui perturbe aujourd’hui toute logique majoritaire.
Si l’on observe ce champ, deux cohérences semblent se dessiner plus nettement que d’autres. Elles tendent à opposer deux projets de société : l’un est à la fois libéral, autoritaire et ouvert sur l’extérieur (l’Europe, le monde) ; l’autre est à la fois « illibéral », protectionniste et excluant. Sans qu’ils soient majoritaires, ce sont ces deux cohérences relatives qui attirent plus fortement que les autres au premier tour, ce qui leur permet de propulser leurs candidatures vers le second tour. Le macronisme prospère sur la base de la première cohérence ; le lepénisme sur celle de la seconde. Chaque ensemble a par ailleurs son incarnation provisoire : même si Macron et Le Pen repoussent plus qu’ils n’attirent, leur attraction est suffisante, au moins dans leur espace, pour parvenir au « tour décisif ».
Ni la droite classique, ni la gauche ne donnent à ce jour l’impression de disposer d’une proposition au moins aussi attractive : la droite classique est écartelée entre Macron et Le Pen ; la gauche dans son ensemble, rivée à son score modeste de 2017, se demande sur quelles bases reconquérir les classes populaires. Du coup, la tendance générale est inquiétante : c’est vers la droite que se trouve la dynamique politique et vers une droite de plus en plus à droite et d’ores et déjà largement populaire. Si un bloc sociopolitique peut se constituer à court terme, il est peu vraisemblable qu’il le fasse du côté gauche. Qui rêve de « bloc populaire » doit savoir que ce bloc est pour l’instant largement dominé.
De plus, sa métaphore pousse la force qui l’utilise à mettre l’accent sur sa différence, alors même qu’elle s’affirme désireuse de rassembler. Dans les faits, qu’elle soit ancienne ou récente, la référence à un « bloc » ou à un « camp », socialement composite mais politiquement réuni, est toujours utilisée pour délégitimer le jeu des alliances partisanes, tenues pour inefficaces et dangereuses.
Résumons-nous… Le vocabulaire du bloc pêche par trois aspects : il est plus qu’incertain dans l’énoncé de ses limites ; il exagère la cohérence des regroupements sociaux qu’il met au cœur de ses logiques ; il suppose une corrélation mécanique entre des situations sociales et des dispositifs politiques. Quant au qualificatif de « populaire » tel qu’il est employé ici, ou bien il apparaît comme un vague ersatz d’un vocabulaire de classe, ou bien il est un clin d’œil nostalgique à une taxinomie sociale familière, mais en partie dépassée. Ce n’est pas parce que leur existence persiste que « peuple » et « bourgeoisie » fonctionnent à l’identique. Au bout du compte, la rhétorique du bloc risque d’être le justificatif d’un cheminement solitaire, plus qu’un opérateur efficace pour penser l’action collective.
Le pivot de l’émancipation
La question des classes populaires est bien sûr stratégique. Se détourner d’elles, au motif qu’elles sont massivement attirées par l’extrême droite, est bien évidemment une folie : on se souvient que le think tank socialisant Terra Nova le suggérait au début des années 2000. Mais la logique « destituante », qui consiste à attiser la colère ou la haine contre la « caste » ou « l’élite » risque d’être de plus en plus contre-productive. Ce n’est pas la colère en elle-même qui peut constituer les catégories populaires dispersées en multitude qui lutte et en peuple conscient de lui-même.
« Bloc ouvrier et paysan » contre « bloc bourgeois » (1924), « classe contre classe » (1927-1933), « camp de la paix » contre « parti américain » (1947-1953), « bloc bourgeois » contre « bloc populaire »… Chaque fois, la logique du « bloc » fait l’effet d’une théorisation involontaire de l’impuissance, qui peut vouer tout projet d’émancipation et toute perspective de gauche à la minorité structurelle.
Aucune stratégie politique ne se déduit aujourd’hui d’un discours général sur les classes. Elle est par définition une construction collective et globale, alliant du social, du politique et du symbolique, mêlant de l’expérimentation patiente et des audaces politiques. Mais nulle dynamique rassembleuse n’est possible si elle ne se construit pas autour de quelques convictions simples et partagées. Celles qui sont énoncées ici ne sont que des ébauches personnelles, ni un programme, ni un projet. Elles sont formulées en six points lapidaires :
1. Le peuple sociologique, dominé par les ouvriers et les employés, est toujours le plus nombreux et le plus subalterne. Il est toujours le peuple, mais il n’est plus celui d’hier, ni dans ses activités, ni dans ses modes de vie, ni dans ses affects. Il n’échappe pas, pas plus que tout autre groupe social, à une individuation qui fonde le désir d’autonomie et redéfinit radicalement le rapport de l’individuel et du collectif. Au fond, préférer le peuple (plus large) ou la classe (théoriquement plus compacte) relève souvent d’un même oubli. Ni la classe ni le peuple ne sont des données toutes faites : elles se construisent et se reconstruisent. Il ne suffit donc pas de juxtaposer leurs éléments épars, mais de créer les conditions de leur mise en commun.
Il ne s’agit bien sûr pas d’ignorer ici le poids de la position sociale dans la distribution des votes. Quand elles font leur choix, les catégories sociales supérieures (les « CSP+ » des sondages) ont une propension massive à se tourner vers la mouvance macronienne et la droite classique. En revanche, les catégories populaires s’abstiennent ou se portent vers l’extrême droite (à la présidentielle) ou vers la droite (aux législatives). Ce qui est avéré est que les catégories les plus modestes ne se tournent plus guère vers la gauche, même si elles l’ont fait un peu plus pour Mélenchon à la présidentielle de 2017.
Mais si la propension des groupes sociaux à voter est politiquement orientée, la structure des électorats est plus complexe. Tout bien considéré (voir encadré), la part des actifs appartenant aux couches supérieures ou aux couches populaires n’est pas si discriminante entre les électorats. À la limite, les plus opposés socialement semblent être celui de Fillon et celui de Le Pen ; et encore faut-il tenir compte du facteur générationnel (l’électorat Fillon est celui qui compte le plus d’inactifs qui ne sont pas majoritairement issus des milieux les plus favorisés). Macron attire avant tout les couches supérieures, mais n’est pas si surclassé qu’on le pense du côté des catégories populaires. Si l’on en croit les sondages, il pourrait même obtenir à lui seul un pourcentage des ouvriers qui votent supérieur à celui de la gauche présidentielle.
Le plus important n’est pas là. Il est dans le constat que la distribution sociale des électeurs ne se déduit pas d’une simple corrélation entre groupes sociaux et vote. Il fut un temps, pas si lointain mais désormais forclos, où les catégories populaires avaient un groupe central (le monde ouvrier) et où ce groupe s’était peu à peu constitué en mouvement (le mouvement ouvrier) agissant à la fois sur la scène sociale et dans le champ politique. Sur cette base s’étaient nouées des relations, toujours complexes mais reproductibles, entre la gauche et le mouvement ouvrier. Dans les phases de plus grande expansion (la Libération, les années 1970), cette conjonction a nourri la concentration majoritaire des votes populaires sur la gauche. Ce n’est pas une corrélation sociale mécanique qui raccorde « classe » et « gauche », mais une construction complexe où s’entremêle de l’objectif et du subjectif, du conscient et de l’inconscient, de la pratique et du symbolique.
Chaque ensemble a par ailleurs son incarnation provisoire : même si Macron et Le Pen repoussent plus qu’ils n’attirent, leur attraction est suffisante, au moins dans leur espace, pour parvenir au « tour décisif ». Ni la droite classique, ni la gauche ne donnent l’impression de disposer d’une proposition au moins aussi attractive.
La conjonction s’est défaite : le monde ouvrier n’a pas disparu, mais il s’est disloqué. L’unification relative des classes populaires a laissé la place à une dispersion qui brouille les repères traditionnels de la classe et la gauche est entrée en crise. Dès lors, le champ politique fonctionne de moins en moins en forme de blocs. Les groupes sociaux se portent certes plus ou moins vers tel ou tel groupement politique. Mais ce qui domine est le « plus ou moins » : la réalité du champ politique est celle de sa parcellisation, qui perturbe aujourd’hui toute logique majoritaire.
Si l’on observe ce champ, deux cohérences semblent se dessiner plus nettement que d’autres. Elles tendent à opposer deux projets de société : l’un est à la fois libéral, autoritaire et ouvert sur l’extérieur (l’Europe, le monde) ; l’autre est à la fois « illibéral », protectionniste et excluant. Sans qu’ils soient majoritaires, ce sont ces deux cohérences relatives qui attirent plus fortement que les autres au premier tour, ce qui leur permet de propulser leurs candidatures vers le second tour. Le macronisme prospère sur la base de la première cohérence ; le lepénisme sur celle de la seconde. Chaque ensemble a par ailleurs son incarnation provisoire : même si Macron et Le Pen repoussent plus qu’ils n’attirent, leur attraction est suffisante, au moins dans leur espace, pour parvenir au « tour décisif ».
Ni la droite classique, ni la gauche ne donnent à ce jour l’impression de disposer d’une proposition au moins aussi attractive : la droite classique est écartelée entre Macron et Le Pen ; la gauche dans son ensemble, rivée à son score modeste de 2017, se demande sur quelles bases reconquérir les classes populaires. Du coup, la tendance générale est inquiétante : c’est vers la droite que se trouve la dynamique politique et vers une droite de plus en plus à droite et d’ores et déjà largement populaire. Si un bloc sociopolitique peut se constituer à court terme, il est peu vraisemblable qu’il le fasse du côté gauche. Qui rêve de « bloc populaire » doit savoir que ce bloc est pour l’instant largement dominé.
De plus, sa métaphore pousse la force qui l’utilise à mettre l’accent sur sa différence, alors même qu’elle s’affirme désireuse de rassembler. Dans les faits, qu’elle soit ancienne ou récente, la référence à un « bloc » ou à un « camp », socialement composite mais politiquement réuni, est toujours utilisée pour délégitimer le jeu des alliances partisanes, tenues pour inefficaces et dangereuses.
Résumons-nous… Le vocabulaire du bloc pêche par trois aspects : il est plus qu’incertain dans l’énoncé de ses limites ; il exagère la cohérence des regroupements sociaux qu’il met au cœur de ses logiques ; il suppose une corrélation mécanique entre des situations sociales et des dispositifs politiques. Quant au qualificatif de « populaire » tel qu’il est employé ici, ou bien il apparaît comme un vague ersatz d’un vocabulaire de classe, ou bien il est un clin d’œil nostalgique à une taxinomie sociale familière, mais en partie dépassée. Ce n’est pas parce que leur existence persiste que « peuple » et « bourgeoisie » fonctionnent à l’identique. Au bout du compte, la rhétorique du bloc risque d’être le justificatif d’un cheminement solitaire, plus qu’un opérateur efficace pour penser l’action collective.
Le pivot de l’émancipation
La question des classes populaires est bien sûr stratégique. Se détourner d’elles, au motif qu’elles sont massivement attirées par l’extrême droite, est bien évidemment une folie : on se souvient que le think tank socialisant Terra Nova le suggérait au début des années 2000. Mais la logique « destituante », qui consiste à attiser la colère ou la haine contre la « caste » ou « l’élite » risque d’être de plus en plus contre-productive. Ce n’est pas la colère en elle-même qui peut constituer les catégories populaires dispersées en multitude qui lutte et en peuple conscient de lui-même.
« Bloc ouvrier et paysan » contre « bloc bourgeois » (1924), « classe contre classe » (1927-1933), « camp de la paix » contre « parti américain » (1947-1953), « bloc bourgeois » contre « bloc populaire »… Chaque fois, la logique du « bloc » fait l’effet d’une théorisation involontaire de l’impuissance, qui peut vouer tout projet d’émancipation et toute perspective de gauche à la minorité structurelle.
Aucune stratégie politique ne se déduit aujourd’hui d’un discours général sur les classes. Elle est par définition une construction collective et globale, alliant du social, du politique et du symbolique, mêlant de l’expérimentation patiente et des audaces politiques. Mais nulle dynamique rassembleuse n’est possible si elle ne se construit pas autour de quelques convictions simples et partagées. Celles qui sont énoncées ici ne sont que des ébauches personnelles, ni un programme, ni un projet. Elles sont formulées en six points lapidaires :
1. Le peuple sociologique, dominé par les ouvriers et les employés, est toujours le plus nombreux et le plus subalterne. Il est toujours le peuple, mais il n’est plus celui d’hier, ni dans ses activités, ni dans ses modes de vie, ni dans ses affects. Il n’échappe pas, pas plus que tout autre groupe social, à une individuation qui fonde le désir d’autonomie et redéfinit radicalement le rapport de l’individuel et du collectif. Au fond, préférer le peuple (plus large) ou la classe (théoriquement plus compacte) relève souvent d’un même oubli. Ni la classe ni le peuple ne sont des données toutes faites : elles se construisent et se reconstruisent. Il ne suffit donc pas de juxtaposer leurs éléments épars, mais de créer les conditions de leur mise en commun.
Sur ce plan, comme sur tant d’autres, nous avons changé d’époque. À l’échelle sociale, il n’y a plus de groupe central (la classe ouvrière), ni de mouvement central (le mouvement ouvrier). Les catégories populaires peuvent se présenter en multitude qui lutte (mouvement salarial, Gilets jaunes…) ; elles ne forment pas un peuple politique en état d’infléchir le mouvement de la société tout entière. Leur émancipation suppose leur unification en temps long. Elle n’est pas l’affaire des seuls partis ; mais leur contribution n’est pas secondaire.
2. La base matérielle de cette unification est dans la place qui est socialement attribuée aux catégories populaires. Elle est depuis longtemps définie par la conjugaison de l’exploitation économique, de la domination politique, de la discrimination symbolique et d’une position subalterne. Le maître mot de l’univers populaire est la dépossession : être du côté du peuple c’est être triplement dépossédé, des avoirs, des pouvoirs et des savoirs. Mais l’aliénation qui en résulte est variable, à la fois objectivement et symboliquement. La dépendance commune ne crée pas de l’uniformité, mais une palette complexe d’inégalités et de discriminations, qui se combinent de façon complexe, « intersectionnelle » comme cela se dit souvent. Or de la variation naît la division ; du coup, le « peuple » divisé reste dominé et placé en position seconde.
3. Pour passer de la multitude au peuple politique, une médiation fondamentale doit se penser. Il ne suffit pas, comme cela se fit beaucoup au moment des Gilets jaunes, de s’insurger contre ceux qui cumulent richesses, pouvoirs et savoirs. Il ne suffit même pas de se dresser contre le système qui distribue inégalement les ressources et qui sépare les classes et les individus. Plus que tout, il faut aussi s’appuyer sur la conscience que l’on peut envisager une société qui ne sépare pas, ne hiérarchise pas et ne subordonne pas les individus. La conviction d’une autre société possible était au cœur de la dynamique du mouvement qui a fait des ouvriers dispersés une classe. Cette conviction est aujourd’hui socialement épuisée par les aléas d’un siècle d’histoire.
4. Rassembler le peuple, ce n’est donc pas avant tout regrouper des fragments sociaux, jusqu’à atteindre une majorité sociologique : c’est rassembler à la fois les dominés et ceux qui, quel que soit leur statut, considèrent qu’une société n’est pas vivable si elle ne réconcilie pas l’égalité, la citoyenneté et la solidarité, et si elle n’y ajoute pas la sobriété. Ainsi, l’objectif stratégique n’est pas la construction d’un « bloc populaire », mais la constitution plurielle d’un « pôle d’émancipation », aussi bien collective qu’individuelle, qui soit à vocation majoritaire. Au centre de cette constitution, ne se trouve ni un groupe social ni un mouvement critique particulier ni un programme (même s’il faut formuler des cohérences programmatiques évolutives). La base d’unification se trouve dans un projet, c’est-à-dire une manière de raconter la société telle qu’elle est et telle qu’elle peut être, dès l’instant où une majorité se dessine pour la promouvoir.
5. En janvier 2019, pour combattre le « bloc bourgeois », Le Monde diplomatiquemettait en avant la belle figure du socialiste Jules Guesde, qui niait l’importance des divisions internes à la bourgeoisie et insistait sur son unité profonde de classe. Le mensuel oubliait seulement de rappeler que Guesde combattait à l’époque la position de Jean Jaurès, qui plaidait pour que l’on considère le combat pour la réhabilitation du « bourgeois » Dreyfus comme un devoir du mouvement ouvrier. Plutôt que de rejouer aujourd’hui le combat de la « pureté » doctrinale guesdiste contre « l’opportunisme » jaurésien, mieux vaut se dire que l’équilibre Jaurès-Guesde a dynamisé le monde ouvrier. De même, dans l’entre-deux-guerres, ce n’est pas la logique excluante du « classe contre classe » qui a porté en avant la gauche ouvrière, mais celle du « Front populaire », ouvert à l’alliance avec ceux que les communistes désignaient auparavant comme des membres d’un « parti bourgeois » (les radicaux) voire comme des « social-fascistes » (le PS-SFIO).
Les formules d’hier ne peuvent être celles d’aujourd’hui, même si elles furent les plus propulsives en leur temps. Mais on peut au moins retenir que rassembler le peuple, rassembler la gauche et lutter pour une gauche bien à gauche sont trois dimensions inséparables, et que jouer l’une plutôt que l’autre conduit au désastre. On peut ajouter que rassembler le peuple et rassembler la gauche, c’est penser en même temps ce qui permet à la gauche de retrouver une majorité et aux catégories populaires de revenir au centre du débat public. Il est donc illusoire de croire que l’on peut se débarrasser de la notion de gauche, pour enfin rassembler le « peuple » ; mais il convient de donner à cette gauche le projet, les mots, les symboles et les formes d’organisation qui lui donnent sa dynamique et lui permettent d’assurer sa mission. Une gauche dynamique et rassemblée ne peut être qu’une gauche refondée, dans sa manière de regarder la société et de la nommer, tout comme dans sa manière d’écrire le récit d’une possible émancipation.
6. Dans l’immédiat, le plus grave serait de sous-estimer le danger représenté par l’extrême droite. Cela suppose de combattre sans compromission ses idées, même celles qui semblent gagner massivement le monde populaire. Cela suppose aussi de repousser tout ce qui, d’une façon ou d’une autre, relativise la gravité de son expansion : l’arrivée au pouvoir de l’équivalent des Orban, Bolsonaro voire Trump serait en France une régression démocratique globale et pas le simple prolongement des dérives en cours. Pour éviter cette régression, on ne peut pas accepter n’importe quoi ; mais on ne peut pas non plus relativiser le pire, même au nom du désastre existant.
Ces réflexions très générales n’ont pas vocation à s’opposer à quelque candidature que ce soit, du côté de la gauche. Mais elles suggèrent que, pour l’instant, aucune ne semble pleinement en état de redonner à la gauche toute la vigueur nécessaire. En 2007, la gauche dite « antilibérale » s’est divisée. Du coup, alors qu’elle avait marqué de son empreinte la bataille contre le projet de Traité constitutionnel européen, elle s’est trouvée cruellement marginalisée. La compétition en son sein se réduisit à savoir qui serait le plus grand des « petits » (c’est Besancenot qui gagna alors la partie).
Il ne faudrait pas que, en 2022, la mésaventure advienne à la gauche dans son ensemble. Dans la course au sondage, Mélenchon est en tête. Mais l’écart avec ses concurrents semble s’être réduit. Et, chaque fois que l’hypothèse d’une candidature commune est évoquée, comme les autres la sienne n’attire pas la moitié du total du capital théorique de la gauche. L’ambition de Mélenchon reste certes d’y parvenir. Le texte de son blog, qui se construit autour de l’antagonisme entre « bloc bourgeois » et « bloc populaire », est l’axe proposé à ce jour. Ce n’est pas faire preuve de « Mélenchon-bashing » que de souligner les insuffisances d’une cohérence qui, si elle restait en l’état, risquerait de reproduire, peut-être en pire, les défauts qui furent ceux du « populisme de gauche ». Et ce n’est pas faire preuve de mépris pour les autres hypothèses à gauche, que de dire qu’elles n’offrent pas – pas plus que l’actuel récit mélenchonien - d’alternative franchement enthousiasmante.
Si le débat citoyen a une vertu, il devrait s’essayer à donner à la gauche le souffle d’un projet. S’il y a débat à gauche, au moins que ce soit sur le fond des projets politiques, et pas seulement sur des mesures programmatiques. Peut-être, de ce débat, surgira-t-il la lumière d’ une unité capable de contenir le ressentiment et, mieux encore, de réveiller l’espoir.
Roger Martelli
LA CARAVANE DES JOURS HEUREUX... C'EST PARTI !
Du 6 juillet au 26 août, la caravane des Jours Heureux, floquée aux couleurs de la campagne de Fabien Roussel, s’élancera sur les routes françaises pour présenter aux habitant·e·s, aux saisonnier·e·s et aux touristes la candidature communiste à l’élection présidentielle de 2022. Cette caravane d’été sera le premier grand temps de mobilisation depuis le vote des militant·e·s pour la candidature de Fabien Roussel à l’élection présidentielle le 9 mai dernier.
La caravane partira de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, pour rejoindre Malo-les-Bains, dans le Pas-de-Calais, en passant par la côte Méditerranéenne, le littoral atlantique et les côtes de la Manche. Ce sont au total 25 fédérations de notre parti qui prendront part à cette belle aventure estivale, pour plus de 30 étapes prévues et 4 000 km parcourus ! Une ébauche de parcours avait été préparée en amont, à la présentation du projet aux fédérations, mais ce sont elles qui ont vraiment décidé des lieux d’implantation de la caravane dans chaque ville traversée. L’une des forces de notre parti est ce découpage en fédérations, qui permet un ancrage local extraordinaire, au plus près des gens et des militant·e·s et une meilleure connaissance du terrain.


Si la caravane d’été est l’occasion rêvée pour rencontrer un grand nombre de personnes, elle sera aussi un grand moment d’échanges et de rencontres avec les camarades des fédérations traversées. Nous n’avons que rarement l’occasion de rencontrer les camarades des fédérations autres que la nôtre et la crise sanitaire a empêché la tenue des grands événements qui nous rassemblent d’habitude, comme la Fête de l’Humanité ou l’université d’été. La caravane d’été sera donc l’occasion de renouer des liens autrement qu’en visioconférence et de relancer les rencontres entre camarades.
« Le communisme est toujours déjà à l’ordre du jour »
Pourriez-vous nous dire d’abord pourquoi vous avez souhaité être partie prenante de cet anniversaire et de ce hors-série exceptionnel de l’Humanité ?
On ne refuse pas l’honneur de s’exprimer dans le journal de Jaurès et de générations de militants, surtout dans une période aussi critique que celle que nous traversons maintenant. C’est aussi une occasion privilégiée de contribuer à la discussion entre tous ceux qui, dans notre pays et ailleurs, refusent l’injustice de la société capitaliste et aspirent à une révolution communiste. Le contenu et les voies de celle-ci doivent néanmoins être repensés pour être à la hauteur des conditions de notre temps, en tirant les leçons d’un passé où figurent tout à la fois les actions les plus héroïques, de grandes luttes d’émancipation et les pires erreurs ou même des crimes contre l’humanité. J’ai appartenu au Parti communiste français et je ne me renie pas. J’en suis venu à questionner non seulement telle ou telle orientation, mais la « forme-parti » elle-même comme support de l’action révolutionnaire. Du moins comme support« exclusif ». Une forme qui d’ailleurs prête à d’extraordinaires variations. Ce qu’on appelle aujourd’hui parti n’a rien à voir avec ce que Marx et Engels entendaient par là dans le Manifeste de 1848, à savoir un mouvement politique d’ensemble de la classe exploitée reposant sur de multiples formes de solidarité. Et si vous regardez quels partis se disent communistes aujourd’hui, vous avez d’un côté une formation politique de gauche comme le PCF, insérée à la fois dans la lutte des classes et dans le pluralisme démocratique bourgeois, de l’autre côté un parti unique d’État qui conduit la Chine vers l’hégémonie mondiale en construisant un modèle remarquablement efficace de capitalisme autoritaire. On ne peut pas imaginer plus grand écart, et pourtant ces deux partis communistes ont été fondés à moins d’un an d’intervalle, sur la lancée de la révolution d’Octobre. C’est ce type de contradiction, où se concentre toute l’histoire du siècle, qu’il nous faut analyser en même temps que nous cherchons à faire passer dans la réalité notre engagement révolutionnaire.
À propos d’engagement révolutionnaire, justement, de nombreux mouvements contestent aujourd’hui le capitalisme. De multiples expériences et actions s’appuient sur des rapports non capitalistes et peuvent même se définir comme communistes ou s’inscrivant dans une « visée communiste ». Dans votre dernier livre [1], vous parlez d’« insurrections » et considérez la révolution comme un processus. Est-ce là votre conception du communisme ?
Dans mon livre, j’ai dit deux choses. D’une part, face à la catastrophe affectant les vies de milliards d’êtres humains, dans laquelle se combinent les ravages d’un capitalisme sans contrôle avec la destruction de l’environnement, il faut travailler à un programme « socialiste » pour l’humanité du XXIe siècle, dans lequel se rejoindraient des régulations économiques et environnementales planétaires, des insurrections populaires et des utopies concrètes, expérimentant à petite ou grande échelle de nouveaux modes de vie en commun. D’autre part, un tel programme, dès lors qu’il implique des redistributions massives de ressources, de travail et de pouvoir, n’a de chance de se réaliser que s’il est porté et propulsé par une « subjectivité communiste », une capacité d’action collective révolutionnaire, multiple dans ses formes mais convergeant vers l’imagination d’un autre monde. Or ces deux aspects se rencontrent autour du thème de l’insurrection. C’est le terme-clé dont tout dépend. S’il n’y a pas d’insurrection contre l’ordre existant, rien ne peut évoluer, sinon vers le pire. Mais, justement, il y en a, nous en observons dans toutes les parties du monde et sous de multiples formes, y compris chez nous et chez nos voisins du Sud. Cela dit, la pratique insurrectionnelle pose de redoutables questions, qu’il s’agisse de sa durée, de son unité, de son extension au-delà des frontières, de son caractère démocratique, de ses capacités d’alliance et d’innovation institutionnelle, de son rapport à l’exercice du pouvoir d’État… Je serais tenté de dire que ces questions sont la matière même d’une politique communiste.
La crise sanitaire que nous sommes en train de vivre est venue se surajouter à la crise environnementale et à la crise économique et sociale. En quoi le « capitalisme absolu » nous mène-t-il, comme vous le dites, vers une catastrophe ?
Le terme de crise est problématique, parce qu’il se décline sur plusieurs registres : politique, économique et social, moral ou civilisationnel, qui ne vont pas automatiquement de pair. Son application dépend du point de vue (en particulier de classe) auquel on se place. La crise des uns n’est pas automatiquement celle des autres. Pendant plus d’un siècle, les marxistes, imbus d’une conception déterministe de l’économie et de l’histoire, ont cru qu’une crise générale du capitalisme ouvrait la voie à la transformation de la société, pourvu qu’une force politique dotée de « conscience » sache s’en saisir. Marx a écrit que « l’humanité ne se pose que des problèmes qu’elle peut résoudre ». Rien n’est moins sûr, hélas. Déjà Gramsci avait noté que les institutions du passé peuvent être en voie d’écroulement, sans que pour autant les conditions d’une relève salvatrice soient données. Nous prenons conscience du fait qu’il existe un capitalisme « extractif » qui se nourrit des formes mêmes de sa crise, dans une permanente fuite en avant facilitée par des innovations financières. C’est un des sens qu’on peut attacher à l’expression de capitalisme absolu. L’autre sens, c’est que ce capitalisme a « marchandisé » tous les aspects de l’existence, non seulement la production, mais la reproduction de la vie, la recherche scientifique, l’éducation, l’art, l’amour… Dès lors, il ne se maintient qu’au prix d’un contrôle politique et idéologique de chaque instant, ce qui veut dire aussi une très grande violence et une très grande instabilité. Mais la catastrophe, c’est encore autre chose. Je n’aime pas les discours apocalyptiques, mais je pense qu’il faut cesser de parler au futur des effets du réchauffement, de la pollution ou de la destruction de la biodiversité (dont le Covid-19 semblerait être une conséquence directe), comme s’il s’agissait d’une « catastrophe imminente » que nous aurions les moyens de « conjurer » (Lénine). Il faut en parler au présent, puisque nous sommes dedans, irréversiblement. Notre problème n’est plus de revenir à la vie d’autrefois dans le monde d’autrefois, mais de faire surgir des alternatives, dont certaines sont plus vivables et plus équitables que d’autres. Car, naturellement, la catastrophe n’affecte pas tout le monde de la même façon… Socialisme et communisme sont des termes hérités de l’histoire, dont nous avons à nous demander comment ils permettent d’affronter à la fois la violence du capitalisme absolu et les conséquences de la catastrophe environnementale, qui, bien entendu, ne sont pas séparables.
Vous êtes donc bien d’accord que ce qui est à l’ordre du jour, c’est de penser le post-capitalisme ?
Naturellement je suis d’accord, mais par rapport à la tradition marxiste dont nous venons, je pense qu’il faut une autre conception du temps historique, et de la façon dont s’y insère la politique. C’est aussi cela que signale la nouvelle articulation des notions de « socialisme » et de « communisme », qui ont été longtemps en concurrence pour désigner ce post-capitalisme, mais avaient fini par être associées dans un schéma linéaire : le socialisme comme « transition au communisme », autrement dit d’abord le purgatoire et ensuite le paradis… J’ai l’air d’ironiser, mais tout cela était très sérieux et même tragique. Dans l’URSS stalinienne, on pouvait aller au goulag pour une mauvaise interprétation des « phases de transition », du « dépérissement de l’État », etc. Le plus intéressant, cependant, dans les débats qui ont suivi la révolution d’Octobre, je pense aux élaborations de Lénine dans la période de la NEP et à la façon dont elles ont été repensées par quelqu’un comme Robert Linhart, c’est l’idée d’une « transition sans fin prédéterminée », soumise en permanence aux aléas de ses propres rapports de forces internes. L’enjeu est l’équilibre instable de l’étatique et du non-étatique, du marchand et du non-marchand. À quoi j’ajouterais aujourd’hui impérativement celui de la croissance et de la décroissance, de l’industrialisation et de la désindustrialisation. Contrairement aux aperçus d’Althusser dans ses derniers textes, aux positions très élaborées de Lucien Sève ou d’Antonio Negri, chacun à sa façon, je n’en conclus pas qu’il faut se débarrasser de la catégorie de socialisme pour « mettre le communisme à l’ordre du jour ». Le communisme est toujours à l’ordre du jour, parce que, sans lui, comme force agissante, rien ne se passe. Mais le socialisme, après avoir représenté une « alternative étatique » au capitalisme, qui lui a permis de se transformer en capitalisme absolu, pourrait nommer un « renversement historique » de ses tendances destructives, sous l’effet de luttes de classes et de mouvements insurrectionnels suffisamment puissants. À moins qu’on ne trouve un meilleur nom.
Vous prenez donc à votre compte la formule de Marx, dans la célèbre thèse sur Feuerbach : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes façons, il s’agirait de le transformer… »
Oui, je m’en inspire en effet, mais à une double condition. La première, c’est de la dégager de toute compréhension volontariste. On ne décide pas de « transformer le monde », mais on s’engage de toutes ses forces, avec d’autres, dans un processus de transformation déjà en cours, qui n’est pas déterminé d’une façon unique, pour y « faire une différence » qui peut-être changera tout. Ici je m’inspire de Ernst Bloch, qui a donné l’une des lectures les plus profondes des Thèses de Marx : il ne peut y avoir de transformation du monde que sur la base d’une transformabilité, d’un incessant « devenir autre » de ce monde, et non pas d’une opposition simple, non dialectique, entre le statu quo et le changement. La seconde condition, c’est de ne pas lire l’antithèse interprétation-changement comme une alternative absolue. L’histoire nous a appris que si on n’interprète pas, c’est-à-dire si on ne prend pas le risque de l’analyse, de la théorie et de l’imagination, on ne transforme rien, ou on transforme pour le pire. Marx doit nous servir à cela, mais bien d’autres ressources sont nécessaires, dont certaines peuvent le contredire, en particulier sur sa conception évolutionniste de l’histoire : Spinoza, Nietzsche, Max Weber, Walter Benjamin, Freud, Foucault, Arendt, Spivak, Mbembe… Ce n’est que mon échantillon personnel.
Mais, au bout du compte, vous n’avez pas bien précisé quelle était votre conception du communisme, ou vous en êtes resté à l’idée d’une « subjectivité collective agissante », sans lui donner un sens. Les lecteurs risquent d’être déçus… Alors, qu’en est-il ?
C’est qu’il fallait d’abord tenter de débrouiller la question du « post » dans le post-capitalisme, d’expliquer pourquoi il est urgent, dans un contexte de catastrophe, de lui opposer des alternatives radicales, tout en sachant qu’on n’en aura pas fini avec lui dans un avenir prévisible. Cela veut dire en particulier que je ne crois pas que le communisme désigne un « mode de production » comme un stade de l’histoire de l’humanité. Je crois que le communisme est une praxis et un mode de vie. Il nomme le fait que les individus se battent pour surmonter « l’individualisme », la façon dont la société bourgeoise les oppose les uns aux autres dans une concurrence féroce qui traverse tous les rapports sociaux, depuis le travail jusqu’à l’éducation et à la sexualité. Mais, ce point est décisif, ils se battent sans dissoudre pour autant leur subjectivité dans une identitéou dans une appartenance communautairedonnée, qu’elle soit de type ethnique, religieux ou même politique. Marx est proche de cette idée dans ses textes de jeunesse, à peu près contemporains des Thèses sur Feuerbach. On voit bien qu’elle désigne plutôt un problème qu’une solution, car il s’agit d’une sorte de cercle carré, ou d’une unité de contraires. Et c’est ce qui en réalité fait sa force. On peut entendre ainsi en particulier la fameuse phrase de l’Idéologie allemande qui « définit » le communisme comme « le mouvement réel qui abolit l’état de choses existant ». Les déterminations qu’il a ajoutées ensuite, qu’il s’agisse de substituer le « commun » à la propriété privée, d’étendre la démocratie au-delà des formes bourgeoises de la délégation de pouvoir, de surmonter la division du travail manuel et intellectuel, enfin et surtout l’internationalisme (et donc l’antimilitarisme et l’antiracisme), ont à la fois pour effet de traduire l’idée du communisme en objectifs politiques et de lui conférer une signification anthropologique, c’est-à-dire de l’étayer sur tous les rapports qui unissent les humains entre eux mais aussi les répartissent en « maîtres » et « esclaves ». Et de ce point de vue, la liste est ouverte. Le mouvements des femmes, le post-colonialisme, le décolonialisme et l’écologie dans leurs différents intersections, ont ajouté des dimensions à la question que posait Marx, tout en créant des difficultés pour une anthropologie qui était essentiellement, sinon uniquement, centrée sur l’homme en tant que « producteur ». Voilà ce que j’ai à l’esprit quand je parle de « subjectivité collective agissante », réfléchissant au présent sur les conditions de son action. C’est pourquoi j’ai toujours tenté de substituer à la question « Qu’est-ce que le communisme ? », qui est une question abstraite et métaphysique, la question « Qui sont les communistes ? », et mieux encore : « Que faisons-nous,les communistes, quand nous nous battons pour changer la vie ? »
Cet entretien a été publié dans le hors-série Besoin de communisme édité par l’Humanité le 10 décembre 2020.
Inscription à :
Articles (Atom)




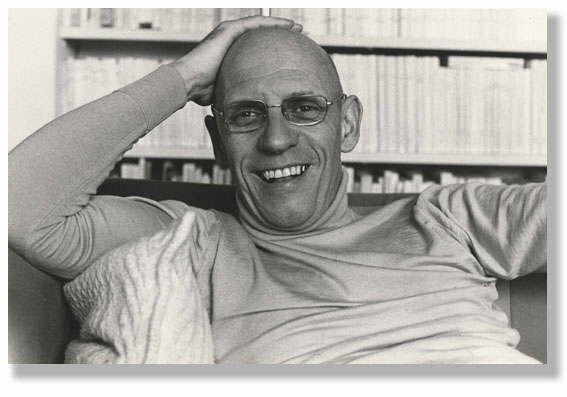
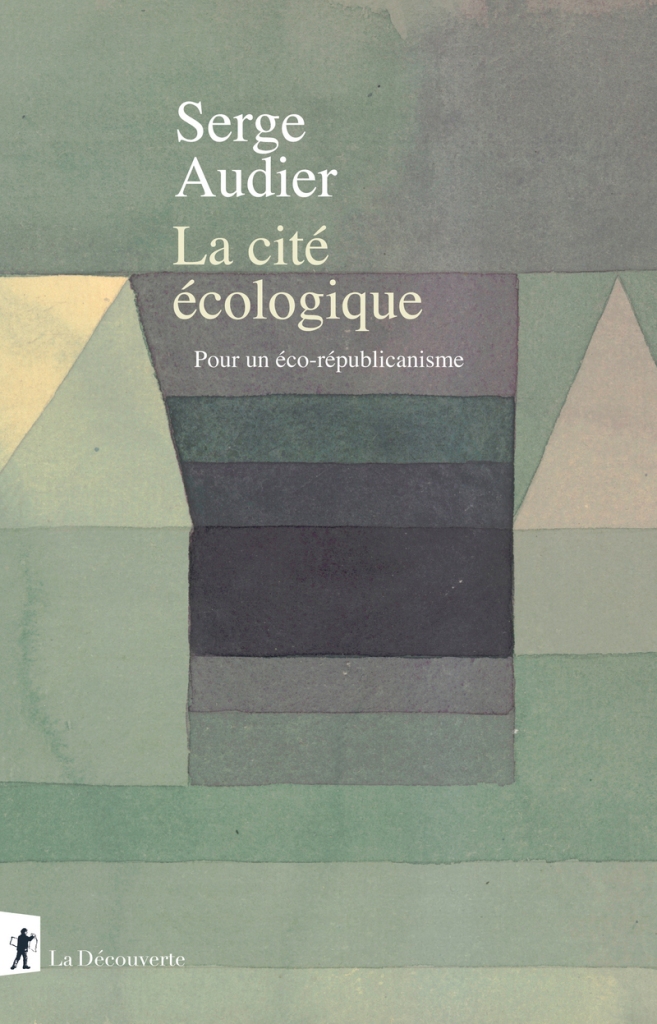
/image%2F1445552%2F20150209%2Fob_1e45f9_logo-communard.jpg)



